Philosophie sur le zinc !
- 1 072 réponses
- 43 participants
- 44 826 vues
- 25 followers
Anonyme
Philosophie sur le zinc !
Patron, vous m’en remettez-une, siouplaît…
Tu kiffes cogiter sur des questions dont la plupart des gens se foutent, sache que tu n’es pas seul au monde…
Tu mates sur ARTE les émissions de Raphaël Enthoven… tu es abonné à Sciences humaines, Philosophie magazine, ou Esprit, voire les trois,
T’aimes les sciences humaines : la sociologie, la psychologie - voire la psychologie sociale,la philosophie des sciences, l’art, la comparaison des systèmes culturels, la spiritualité,
Ma philosophie d'Amel Bent est le morceau qui arrive en premier sur ta playlist,
Tu passes ton bac,
Que tu sois camusien ou sartien,
Prends une chaise et un verre ….
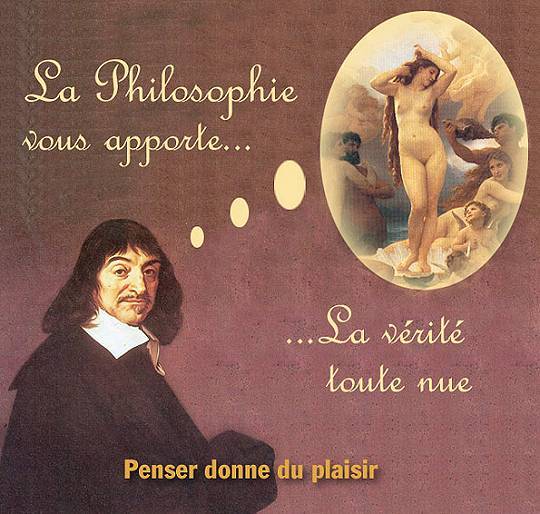
[ Dernière édition du message le 16/11/2013 à 12:54:42 ]
Rage is Walrus
on te ramène des lecteurs et tu te plains ![]()
Anonyme
Pour ceux qui suivent encore
Citation :
Le jour où Sartre a répondu à Freud
Connaissez-vous la proposition sartrienne d’une « psychanalyse existentialiste »? Sartre était tellement fasciné par Freud qu’il a essayé de fonder une forme de psychanalyse concurrente, reposant sur l’idée… que l’inconscient n’existe pas ! Ce que Freud nomme l’inconscient n’est pour Sartre qu’une conscience de mauvaise foi : l’homme ne veut pas voir ce qu’il a refoulé, mais qu’il a bien dû « voir » au moment de le refouler – sinon, il n’y aurait pas eu refoulement. Nul inconscient profond chez Sartre, ni de libido exprimant l’intensité de l’énergie associée aux pulsions refoulées, juste une zone de la conscience que l’homme ne veut pas voir, incapable de cette honnêteté vis-à-vis de lui-même.
L’inconscient ainsi redéfini, et donc nié, ne peut en conséquence déterminer l’homme à être ce qu’il est : l’homme n’est plus déterminé par son passé; il est libre de s’inventer à chaque instant. Comment refonder la psychanalyse si l’on pense que l’individu n’est pas le produit de son passé ? En proposant, comme Sartre dans L’Être et le Néant, d’allonger les individus pour leur permettre d’entendre, non pas leur passé… mais leur avenir ! De trouver un projet capable de redonner du sens à leur vie, de rendre leur passé supportable, voire d’en faire une force.
Pour Sartre, le passé n’existe pas : il n’a aucune réalité objective. Il se donne à nous en fonction de la manière dont nous nous projetons dans l’avenir. Reste à trouver le projet – la finalité – qui changera l’obstacle (un passé douloureux) en opportunité. L’angoisse, qui plongeait selon Freud ses racines dans notre passé, s’éclaire alors chez Sartre de notre rapport à l’avenir. Vous avez le vertige, une peur phobique des balcons trop élevés ? Inutile d’aller chercher dans votre enfance l’introuvable clé de l’énigme. C’est l’avenir qui vous angoisse, l’avenir tout proche : de ce balcon, vous pourriez vous jeter dans le vide. Finalement, c’est votre liberté qui vous angoisse, cette liberté qui peut être « monstrueuse », l’angoisse devenant le symptôme de cette douloureuse prise de conscience de votre liberté.
Pour en sortir, il s’agissait chez Freud de saisir la manière dont nous sommes pris dans le destin, Sartre nous propose d’assumer pleinement cette liberté qui est aussi l’origine de notre angoisse. Toujours la même histoire : la liberté contre le destin. On imagine très bien le dialogue entre les deux. Freud : « Ainsi, vous proposez simplement de guérir les hommes en leur donnant un projet ? » Sartre : « Eh bien oui, c’est toujours mieux que de leur donner un destin ! » C’est probablement Freud qui a raison. Mais Sartre plaît beaucoup plus aux partisans de thérapies brèves et aux coachs pressés, par temps de crise, de « changer les obstacles en opportunités »…
[ Dernière édition du message le 05/12/2013 à 16:18:02 ]
Simon De Talbert
![]() lire "saint-genet comédien et martyre" de Sartre; une excellente étude qui constamment fait référence à l'inconscient-un psychanalyste n'aurait pas fait mieux tout ça pour en arriver à l'idée que l’inconscient n'existe pas et que l'homme est libre dès lors qu'il assume son destin.
lire "saint-genet comédien et martyre" de Sartre; une excellente étude qui constamment fait référence à l'inconscient-un psychanalyste n'aurait pas fait mieux tout ça pour en arriver à l'idée que l’inconscient n'existe pas et que l'homme est libre dès lors qu'il assume son destin.
quand à Onfray, n'a-t-il pas le désir de soigner avec ses universités populaires (qui ont beaucoup de succès il faut le reconnaître);
"Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible" M. TWAIN
Anonyme
"L'être humain forme l'essence de sa vie par ses propres actions, en opposition à la thèse que ces dernières lui sont prédéterminées par de quelconques doctrines théologiques, philosophiques ou morales. L'existentialisme considère donc chaque personne comme un être unique qui est maître, non seulement de ses actes et de son destin, mais également, pour le meilleur comme pour le pire, des valeurs qu'il décide d'adopter."
Me souviens plus où j'avais lu que la pensée de Sartre plaisait beaucoup aux adolescents : l'idée d'absolue liberté de l'homme.
[ Dernière édition du message le 05/12/2013 à 17:03:56 ]
Rage is Walrus
![]()
intram
Anonyme
Anonyme
Sommes-nous libres de nos choix ?
Oui, répond le philosophe Robert Misrahi, car nous sommes toujours responsables des décisions que nous prenons… ou pas. Non, répond la psychologue et psychanalyste Dominique Miller, car nous sommes menés – et parfois malmenés – par notre inconscient…
Psychologies : Pouvons-nous vraiment choisir le cours de notre existence ?
Dominique Miller : Choisir notre vie ? La psychanalyse le propose. Elle suggère de repérer les obstacles récurrents qui se dressent systématiquement devant nous à chaque fois que nous essayons d’être en accord avec nos désirs.
Robert Misrahi : « Résistances », « obstacles »… La psychanalyse part du principe que nous sommes malades ! Et si nous commencions par considérer un individu qui aille bien ? Un individu qui puisse se dire : « Si je ne veux pas le faire, je peux ne pas le faire » ? Je pense que nous sommes tout-puissants. Nous sommes totalement libres de choisir notre vie et d’accéder par là au bonheur.
Si nous pouvons choisir, alors pourquoi faisons-nous si souvent notre malheur ?
R.M. : Nous fabriquons souvent notre propre malheur en prenant de mauvaises décisions, dictées par ce que je nomme notre « conscience spontanée » : un état ignorant, déchiré, dans lequel des désirs primaires nous agitent et nous gouvernent. Ces désirs confus, aveugles, sont des désirs de possession, de pouvoir, de jouissance, qui ne tiennent absolument pas compte de la réalité du monde et ne peuvent pas être assouvis sans nuire à autrui ou à nous-même. Pour caricaturer, la « conscience spontanée », c’est un peu l’illusion du « je peux faire n’importe quoi ». Mais ce n’est pas l’inconscient, auquel je ne crois pas…
D.M. : Les « mauvais » choix que nous faisons sont généralement liés à un événement essentiel de notre histoire qui, souvent, se rencontre dans notre enfance. Cet événement obscur est parfois raconté, parfois tu; il peut être massif (la mort d’un être cher liée à notre naissance, la séparation de nos parents…), ou apparaître anodin (un accident vécu ou vu, une humiliation à l’école, une colère parentale, etc.). Il marque profondément sans qu’on le sache. Il fait tellement vérité pour nous qu’il pèse sur nos décisions dans les moments cruciaux de notre vie (choix amoureux, orientations professionnelles…). Il a une telle influence inconsciente qu’il contribue à nourrir, voire à causer, ce qu’en psychanalyse nous appelons un « symptôme ». Des exemples : ne pas pouvoir parler en public ou prendre le métro, être la proie de crises de panique, se trouver embarrassé lors d’une rencontre amoureuse, ou bloqué à l’idée d’avoir un enfant, ou encore ne pas pouvoir s’empêcher de trop manger ou de trop fumer, et enfin se mettre dans une position insatiable de demande d’amour… À cause de lui, nous nous mettons systématiquement en « excès » ou en « déficit » par rapport à notre désir, tout en ayant l’impression d’un « c’est plus fort que moi ! »
Si nous cédions moins à nos pulsions ou si nous étions plus « éveillés », nous pourrions donc faire des choix qui permettent d’accéder au bonheur ?
D.M. : La psychanalyse pense que nos désirs ne peuvent jamais être comblés. Nous voulons un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas obtenir. Nous avons l’idée qu’il y a des raisons sociales à cela; mais nous ignorons qu’il existe des raisons intérieures, structurales. Car nous nous construisons à partir d’un défaut, d’un manque, non pas à partir de la réflexion ou d’une « planification » d’objectifs à remplir. En revanche, nous pouvons, par la psychanalyse ou par certaines circonstances, apprendre à nous accommoder de cette faille, au point d’en tirer parti. Prenons le cas d’une personne passionnée par la photographie, mais qui échoue dans cette voie qu’elle a choisie. Je ne pense pas qu’on l’aidera en lui conseillant de suivre telle ou telle formation, de postuler dans tel ou tel endroit… Je pense qu’il faudrait plutôt l’amener à interroger sa passion : pourquoi est-elle fascinée par l’image ? Pourquoi cela la mobilise-t-elle ? Pourquoi veut-elle persister alors qu’elle ne parvient pas à percer ?
Traumax
je choisis la voie de Mesrahi.
intram
Oui, répond le philosophe Robert Misrahi, car nous sommes toujours responsables des décisions que nous prenons… ou pas. Non, répond la psychologue et psychanalyste Dominique Miller, car nous sommes menés – et parfois malmenés – par notre inconscient…
Quand même il y a ce "...ou pas" qui gratte un peu les couilles
Traumax

Genre si tu me demandes de décider qui je préfère entre Sartre et Freud, je te réponds que je m'en fous, du coup je prends pas de décision.
Ou alors on considère que je prends la décision de m'en foutre ?
Simon De Talbert
![]() "Je pense que nous sommes tout-puissants. Nous sommes totalement libres de choisir notre vie et d’accéder par là au bonheur."
"Je pense que nous sommes tout-puissants. Nous sommes totalement libres de choisir notre vie et d’accéder par là au bonheur."
belle santé ce Robert Misrahi; il doit être tout jeune non?
"Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible" M. TWAIN
Anonyme

Robert Misrahi est un philosophe français, né à Paris le 3 janvier 1926. Spécialiste de Spinoza, il consacre son travail à la liberté et au bonheur. Professeur émérite de philosophie éthique à l'Université de Paris I (Sorbonne), il a publié de nombreux ouvrages sur Spinoza et consacré l'essentiel de son travail à la question du bonheur1. Il lui arriva par ailleurs de publier plusieurs articles dans Les Temps modernes, Encyclopædia Universalis, Le Dictionnaire des philosophies "PUF", mais aussi Libération, Charlie Hebdo ou le Nouvel Observateur.
[ Dernière édition du message le 05/12/2013 à 18:08:29 ]
Anonyme
[ Dernière édition du message le 05/12/2013 à 18:24:59 ]
Simon De Talbert
ne pas se tromper de direction; ce Monsieur MISRAHI me fait penser à cette réflexion de je ne sais plus qui: "j'ai connu des moments de bonheur, ça ne m'a pas rendu heureux!"
"Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible" M. TWAIN
Rage is Walrus
Citation de : DJ_SHUFFLE
cette réflexion de je ne sais plus qui: "
ca c'est de la précision scientifique ![]()
Simon De Talbert
oui c'est vrai, il y a cette réflexion de je ne sais plus qui , dont je ne me souviens plus précisément la formulation, sur un sujet dont on avait parlé précédemment;
en tout cas je voulais te dire que c'était tout à fait ça que je pensais Régis-
"Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible" M. TWAIN
quantat
Citation de : Traumax
Citation :il témoigne de son ignorance radicale de la notion d'impossibilité structurale (logique et épistémologie)
J'aurais jamais du flaguer en fait. La philo quand ça commence à se gonfler le sur-moi avec ce genre de lexique gazeux, ca n'a aucun sens.
Je t'expliques ça quand tu veux... sans utiliser de gros mots ![]()
quantat
Citation de : Traumax
La psychanalyse qui s'auto-justifie comme panacée à tous les problèmes existenciels, c'est beau comme un coup de latte dans les couilles de BHL.
je choisis la voie de Mesrahi.
Là je suis 100% d'accord avec toi...
Et j'ai beau être "lacanien" (mais hérétique), le jour où les écoles de psychanalyse ferment, je débouche le champagne... ceci dit Mesrahi fait un gros contre sens : pour la psychanalyse il n'y a pas de malade, puisque 'il n'y a pas de NORME ... mais je vois bien qu'il s'en prend à ce que les vautours ont fait de la psychanalyse (finalement ce que dit Onfray, si ça ne vaut pas nécessairement là où il le croit, reste valable pour pas mal d'analystes
a.k.a
Le questionnement réciproque philo/psychanalyse me semble tout à fait pertinent, n'en déplaise à ceux qui jettent tout ce qui vient avec l'eau du bain...
Ni philo ni psycho ne peuvent répondre à un problème existentiel ; la psychanalyse ne traitant que des cas particuliers (et pour rattraper mon retard sur le sujet, à partir du moment où certaines personnes reconnaissent l'apport qu'a permis la psychanalyse dans leurs vies, y a pas à chercher plus loin selon moi, elle se présente comme technique curative et elle fonctionne - il convient de cesser le faux débat) et la philo de cas trop généraux (ce n'est pas en lisant l'Apologie de Socrate ou le Phédonqu'un être singulier saura s'il faut / s'il doit avoir peur de la mort...), il faut en rester là.
En ce qui me concerne je n'ai pas lu l'Éthique de Spinoza et je n'apprécie guère ce que je crois sourdre de cette pensée (pas lu - pour des raisons qui vous échapperont nécessairement et que je ne tiens pas à détailler). En revanche, si les propos des uns et des autres peuvent être étayés par des textes (philo, SS, SH, psy, socio, ethno, etc.) ce serait pas mal parce que j'ai l'impression que le topic fonctionne à un niveau de subjectivité ahurissant. Il suffit d'avoir fait telle ou telle expérience, tel ou tel constat pour dire que bon, voilà, c'est comme ça et puis c'est tout et que tous ceux qui ne sont pas d'accord ne sont que des bas de plafond. Trop facile.
Et les textes ont une raison, celle d'exister, de perdurer dans le domaine des idées et de les faire évoluer. Ça n'est pas tout à fait pour rien qu'ils ont été écrits, si je puis me permettre.
My BHL Point (mais j'aimerais qu'on me prenne au sérieux, merde).

Je précise qu'en cherchant dans mes sujets créés, on en trouvera quelques uns, datés certes, qui ont essayé de traiter du sujet (ou en tout cas d'une sujet qui pourrait s'y rapporter : cf. "Musique et philosophie", "musique : art ou science" et mon regretté "Éthique du sampling", je me rends compte que je me suis fait troller en beauté, cherchez pas, axiste pu)...
Edit > Je trouve ma signature hautement philosophique et pourtant c'est de la poésie...
[ Dernière édition du message le 05/12/2013 à 21:41:25 ]
Rage is Walrus
Bon, rien de tel que de revenir aux grands auteurs en effet
sinon, plus sérieusement, il n'est pas étonnant que la poésie produise des assertions que l'on peut entendre comme philosophique.
J'ai toujours regretté de ne pas comprendre l'allemand et de devoir lire nietzsche en français car j'ai entendu dire que les sonorités de ses textes étaient très importantes.
En outre, l'écriture est une autre facette qui permet de révéler des choses que l'on ignore sur soi-même (que l'on feint ne pas savoir) et les surréalistes l'avaient bien compris
Anonyme
[ Dernière édition du message le 05/12/2013 à 22:01:35 ]
Anonyme
En outre, l'écriture est une autre facette qui permet de révéler des choses que l'on ignore sur soi-même (que l'on feint ne pas savoir) et les surréalistes l'avaient bien compris

[ Dernière édition du message le 05/12/2013 à 22:07:40 ]
Anonyme
En outre, l'écriture est une autre facette qui permet de révéler des choses que l'on ignore sur soi-même (que l'on feint ne pas savoir) et les surréalistes l'avaient bien compris
Freud et la psychanalyse refusent le surréalisme d'André Breton
Freud refusera sa vie durant d’accorder le moindre crédit au surréalisme, ce mouvement esthétique apparu en France dans les années-vingt sous l’impulsion d’André Breton, lequel malgré tout restera toujours admiratif du penseur viennois et revendiquera l’origine de son courant par la découverte de la psychanalyse. Breton voit en effet dans l’inconscient freudien une source d’inspiration artistique. Il s’agit de libérer le surmoi des chaînes conventionnelles et des mœurs qui l’emprisonnent afin de dégager un souffle spirituel contributeur d’un art nouveau. Breton recommande notamment l’écriture automatique qui consiste à écrire sans réfléchir ni à s’inscrire dans un système de pensée, l’inconscient devant guider la main de l’auteur. L’hypnose est également un terrain d’investigation privilégié par le père du surréalisme car elle met à nu celui qui s’y abandonne. André Breton formalise sa pensée dans le Manifeste du surréalisme, en précisant que son mouvement « repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d’associations négligées jusqu’à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée ». Salvator Dali, qui embrassa le surréalisme, rend également hommage à Freud : « Durant la période surréaliste, j’ai voulu créer l’iconographie du monde intérieur, le monde merveilleux de mon père Freud et j’y suis arrivé ». (Manifeste de l’antimatière – Salvator Dali)
Les éloges n’y suffisent pas, Freud reste hermétique aux productions de ces artistes d’un genre nouveau. Selon lui, ils ne font que la promotion de la folie en exposant à outrance des tensions névrotiques dont la représentation n’est pas appropriée. En effet, Freud est un médecin. Pour lui, les dérèglements entre la conscience et l’inconscient sont à soigner, non à exhiber. En outre, Freud le conservateur ne peut adhérer à l’extravagance et la provocation dont les surréalistes se font les chantres.
Simon De Talbert
DALI avait développé sa théorie paranoïaque-critique pour peindre à la suite de la thèse de Lacan sur la paranoÏa
"Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible" M. TWAIN
- < Liste des sujets
- Charte
