Les mots rares qui font classe dans les soirées mondaines
- 639 réponses
- 95 participants
- 61 206 vues
- 83 followers
a.k.a
Merci de faire partager votre liste ici, en précisant le sens du ou des mots.
J'ouvre le bal avec "battre sa coulpe", qui signifie reconnaître ses pêchers, ou "ophiolâtre", qui désigne un adorateur de serpents. Enfin, j'aime beaucoup l'adjectif "superfétatoire", qui s'ajoute inutilement à une chose.
Anonyme
OK ça veut rien dire mais ça fait classe.
Le sotch est un genre de combe ou excavation naturelle que l'on trouve dans les Causses.
Et la bourguignotte est un casque militaire porté au moyen-âge.
Merci Michel Laclos
Truelle est un manchot
Labourguignotte est un casque militaire porté au moyen-âge.
Ah ben j'avais cru qu'on parlait de manger, mais en faite non, c'est de la merde du coup ce thread.
noSkillz
Le sotch est un genre de combe ou excavation naturelle que l'on trouve dans les Causses.
Je croyais que c'était un forfait mobile

Oper-8 Downtempo, ambient | beMYsound Musique à l'image | Fake Luxury Shoegaze, dreampop, synthwave | SeizePads Chillhop, trap, drill
gojats
On en voit plus Armand
Un esprit sein dans un... cornichon ?
Le tout venant a été piraté par les mômes, on se risque sur le bizarre : https://soundcloud.com/gojats
noSkillz
Oper-8 Downtempo, ambient | beMYsound Musique à l'image | Fake Luxury Shoegaze, dreampop, synthwave | SeizePads Chillhop, trap, drill
a.k.a
ÉPIGASTRE, subst. masc.
ANAT. Région médiane et supérieure de l'abdomen, comprise entre l'ombilic et le sternum. Douleur à l'épigastre. Synon. usuel creux de l'estomac; anton. hypogastre.La solidité du point d'appui, qui soutient, à l'épigastre, tous les efforts musculaires (Cabanis, Rapp. phys. et mor.,t. 2, 1808, p. 292).La vive sensibilité de l'épigastre et le resserrement des hypocondres (Balzac, Peau chagr.,1831, p. 256):
... cette réflexion, une fois de plus, déterminait en Joseph une pénible sensation de constriction à l'épigastre, de malaise et même de nausée. Duhamel, Passion Pasquier,1945, p. 180.
Rem. On rencontre ds la docum. épigastralgie, subst. fém., méd. ou pathol. Douleur à l'épigastre (cf. A.-F. Chomel, Élémens de pathol. gén., p. 164, note 1 ds Quem. DDL t. 8).
Prononc. et Orth. : [epigastʀ ̥]. Ds Ac. 1762-1932. Étymol. et Hist. 1539 (J. Canappe, 5elivre de la méth. thérapeutique, p. 78 ds Fr. mod. t. 19, p. 20). Empr. au gr. ε ̓ π ι γ α ́ σ τ ρ ι ο ν proprement « ce qui est au-dessus du bas-ventre », composé de ε ̓ π ι ́ (v. épi-) et de γ α σ τ η ́ ρ, γ α σ τ ρ ο ́ ς « ventre, estomac ». Fréq. abs. littér. : 49.
DÉR.
Épigastrique, adj.Relatif à l'épigastre. Région, artère, douleur épigastrique. Anton. hypogastrique.Une sensation de constriction physique au niveau (...) digestif (boule épigastrique) (Mounier, Traité caract.,1946, p. 233).− [epigastʀik]. Ds. Ac. 1762-1932. − 1reattest. 1654 (Th. Gelée, Anat. fr. en forme d'abrégé [augmentée du Traité des valvules] p. 153); de épigastre, suff. -ique*. − Fréq. abs. littér. : 25.
ORPHÉON1, subst. masc.
HIST. DE LA MUS. Instrument ancien à clavier dont les cordes sont frottées et mises en vibration par une roue. L'orphéon n'est qu'une vielle de grandes dimensions et montée sur pieds (Bouasse,Cordes et membranes, 1926, p.325).
Prononc.: [ɔ ʀfeɔ ̃]. Étymol. et Hist. V. orphéon2.
Sens 2 :
ORPHÉON2, subst. masc.
Société d'éducation musicale populaire, souvent subventionnée par des entreprises privées ou des municipalités, qui regroupe des choristes (amateurs) ou musiciens de fanfare.
A. − Choeur d'hommes. Les élèves de l'Orphéon Leur chantaient Les boeufs aux fenêtres (Banville,Odes funamb., 1859, p.169).La Société chorale «des hommes allemands du Sud» (...) tour à tour susurrèrent et mugirent des morceaux d'orphéons, pleins de sensibilité (Rolland,J.-Chr., Révolte, 1907, p.387).
B. − Fanfare. L'orphéon municipal. Les dimanches d'été, des orphéons promenaient en musique leurs bannières étincelantes de médailles de concours; des pompiers faisaient la parade (A. Daudet,Pte paroisse, 1895, p.26).
Prononc. et Orth.: [ɔ ʀfeɔ ̃]. Att. ds Ac. dep. 1878. Étymol. et Hist. 1. 1767 «instrument de musique» (Encyclop. t. 26, Planches V, lutherie, p.5b); 2. 1837 «école de chant» (B. Wilhem, Orphéon. Répertoire de musique vocale sans accompagnement, v. aussi Fr. mod. t.9, p.48); 1845 «société dont les membres se livrent à l'étude et à la pratique de la musique vocale et du chant choral» (Michelet, Journal, p.596). Dér. sav. du nom de Orphée, v. ce mot, d'apr. odéon*. Fréq. abs. littér.: 32.
DÉR. 1.
Orphéonique, adj.Qui concerne les orphéons. Société orphéonique. [berlioz] préside un festival orphéonique à Grenoble (Prod'homme dsBerlioz, Souv. voy., 1869, préf. (1932), p.12)− [ɔ ʀfeɔnik]. − 1reattest. 1855 (R. anecdotique, 6 déc., vol.1, p.391); de orphéon2«société de chant choral», suff. -ique*.
2.
Orphéoniste, subst. et adj.a) Subst. Membre d'un orphéon. On parle du public de l'Opéra, à l'heure actuelle moins bon juge de la musique et du chant que des orphéonistes de province (Goncourt,Journal, 1875, p.1052).b) Adj. Synon. de orphéonique (supra).[les figurants, dans Léo Burckart] étaient ravis des deux chants populaires, qui sont restés dans les concerts orphéonistes (Nerval,L. Burckart, 1839, p.313).− [ɔ ʀfeɔnist]. Att. ds Ac. dep. 1878. − 1resattest. 1839 adj. «relatif à un orphéon» (Nerval, loc. cit.), 1852 subst. «membre d'une société de chant choral» (Texier, Tabl. de Paris, t.1, p.17); de orphéon2«société de chant choral», suff. -iste*.
BBG. −Quem. DDL t.5, 7 (s.v. orphéonique).
BADINE, subst. fém.
A.− Au sing.
1. Baguette mince et flexible pouvant servir de fouet ou de cravache. Badine à battre les meubles, les habits :
1. C'était une personne rigide et impitoyable, punissant ses élèves de coups de badine appliqués sur les mains avec une énergie suspecte. Green, Journal,1948, p. 170.
− En partic. Petite canne souple et souvent travaillée que portaient les hommes soucieux de raffinement et d'élégance. Synon. stick.Badine à pomme d'or, à tête d'or; badine de jonc, de bambou :
2. ... [noirtier] essaya devant la glace le chapeau à bords retroussés du jeune homme, parut satisfait de la manière dont il lui allait, et, laissant la canne de jonc dans le coin de la cheminée où il l'avait posée, il fit siffler dans sa main nerveuse une petite badine de bambou avec laquelle l'élégant substitut donnait à sa démarche la désinvolture qui en était une des principales qualités. A. Dumas Père, Le Comte de Monte-Cristo,t. 1, 1846, p. 135.
2. Au plur., p. anal., TECHNOL., vx. Petites pincettes à branches minces et flexibles servant à tisonner le feu. Une paire de badines :
3. ... mon soufflet m'impatientait (...) je ne m'en suis pas plaint deux fois. Brst, le lendemain mademoiselle m'a donné un très-joli soufflet, et cette paire de badines avec lesquelles vous me voyez tisonnant. Balzac, Le Curé de Tours,1832, p. 177.
B.− Au fig., arg., au plur. Jambes. Synon. arg. cannes (cf. aussi baguettes) :
4. Elle avait un trac épatant. Un gros terrier (...) avait voulu lui boulotter les badines. La Petite lune,1878-79, no40, p. 2.
Rem. Attesté ds Esn. 1966.
− Cherrer aux badines. ,,Terrasser en saisissant par les jambes`` (Bruant 1901).
PRONONC. : [badin].
ÉTYMOL. ET HIST. − 1. 1743 au plur. (Trév. : Badines ... Pincettes legères qu'on appelle ainsi parce qu'elles servent à badiner & à s'amuser en arrangeant quelques charbons ou petits tisons); 2. 1781, août modes « petite canne », (Corresp. litt., philos. et crit., XIII, p. 13 ds Proschwitz Beaumarchais, p. 326 : Adieu, robins en catogans. Adieu, pédants, basoche, huissiers à sombres mines, En froc puce, poudrés, musqués, Fièrement armés de badines). Déverbal de badiner*, sans doute au sens de « flotter au vent, s'agiter légèrement », p. réf. aux cendres remuées par des pincettes (sens 1) ou à la souplesse de leur extrémité (sens 2).
STAT. − Fréq. abs. littér. : 64.
BBG. − Quem. 2es. t. 3 1972, p. 19.
Traumax
La technique du siège, aussi bien celle de la défense que celle de l'attaque, se nomme la poliorcétique.
https://www.franceculture.fr/emission-concordance-des-temps-de-troie-a-kobane-la-poliorcetique-2015-01-24
a.k.a
a.k.a
a.k.a
Le premier sera utile pour les Samy D., Max T. et quelques autres sans doute.
IMPÉRITIE, subst. fém.
Incapacité, inhabilité, défaut de compétence dans la profession ou plus souvent dans la fonction que l'on exerce. Qu'on n'oublie pas que l'impéritie des administrateurs est une vraie calamité dans les colonies (Baudry des Loz., Voy. Louisiane,1802, p. 178).L'année suivante, l'impéritie des derniers rois turcs locaux lui livra la ville (Grousset, Croisades,1939, p. 226) :
Il ne s'est pas rencontré un député pour demander des comptes aux généraux dont la criminelle impéritie avait fait mourir cinq mille soldats français de la fièvre, sans une seule blessure du feu de l'ennemi. Clemenceau, Iniquité,1899, p. 264.
SYNT. Impéritie administrative, économique, générale; honteuse impéritie; l'impéritie des administrateurs, d'un architecte, de l'état-major, du gouvernement, d'un médecin, des ministres, du pouvoir; accuser qqn, taxer qqn d'impéritie; prouver l'impéritie de qqn en telle matière.
− En partic. [L'incapacité ne se rapporte pas à la profession, à la fonction]
Manque d'aptitude. L'impéritie aux langues étrangères (...) constitue un impedimentum, non un Veto (Montesquiou, Mém., t. 3, 1921, p. 209).
Inhabileté par défaut d'exercice. Pourquoi ne nous apprend-on pas à nous servir indifféremment de nos deux mains? Pourquoi tout cet afflux de forces dans notre droite et cette étrange impéritie de notre gauche? (Green, Journal,1952, p. 190).
Prononc. et Orth. : [ε ̃peʀisi]. Att. ds Ac. dep. 1762. Étymol. et Hist. Ca 1490 l'impéricie... de leur medecin (G. Tardif, Faceties de Pogge, 176 ds Delb. Notes mss); 1531 [date d'éd.] (Raoul de Presles, Cité de Dieu, XVIII, 23, ibid.). Empr. au lat. class.imperitia « manque de connaissance, ignorance, inexpérience », dér. de imperitus « ignorant, inexpérimenté, inhabile » (composé du préf. -in, à valeur négative, et de l'adj. peritus « qui sait par expérience, qui s'y connaît, adroit »), cf. le m. fr. imperice « défaut d'habileté » (1395, Métiers et corporations de la ville de Paris, éd. R. de Lespinasse, III, p. 373, § 3). Fréq. abs. littér; : 44.
Moins facile à placer, ou bien faut être en mesure de réciter Merleau-Ponty derrière :
ECCÉITÉ, subst. fém.
PHILOS. Situation concrète et singulière d'une essence. Les sens et en général le corps propre offrent le mystère d'un ensemble qui, sans quitter son eccéité et sa particularité, émet au delà de lui-même des significations capables de fournir leur armature à toute une série de pensées et d'expériences (Merleau-Ponty, Phénoménol. perception,1945, p. 147).
Prononc. et Orth. : [ekseite]. Écrit avec une minuscule et sans accent aigu ds Lar. Lang. fr. Étymol. et Hist. 1599 (Ph. de Marnix, Différ. de la Religion, I, III, 9 ds Hug.). Dér. savant du lat. ecce « voilà »; suff. -ité*. Fréq. abs. littér. : 11. Bbg. Dub. Dér. 1962, p. 38
Je connaissais son synonyme, "quiddité" [kwidité].
[ Dernière édition du message le 05/12/2015 à 01:48:48 ]
Javier Guante Hermoso
Traumax
Ecceite est très bien mais je suis pas sûr d'avoir saisi le sens.
Traumax
Ecceite est très bien mais je suis pas sûr d'avoir saisi le sens.
Djardin
ECCÉITÉ, subst. fém.
PHILOS. Situation concrète et singulière d'une essence
ma voiture n'est pas Diesel. Elle roule donc grâce à l'eccéité. ?
Référence en matière de bon gout capillaire et vestimentaire.
homme à tête de zizi.
Anonyme
Autre manière de l'expliquer : c'est la propriété d'un individu d'être lui-même / distinct de tous les autres individus. Ça remonte à Dun Scott, ce petit joyau fumesque et ténébral.
[ Dernière édition du message le 05/12/2015 à 14:42:33 ]
a.k.a
Dja >
Autre synonyme d'eccéité, moins philosophique car débarrassé de la dimension métaphysique : idiosyncrasie.
Anonyme
des individus pourraient avoir exactement le même comportement (donc pas d'idiosyncrasie) tout en restant, par essence, distincts les uns des autres,
c'est pas la même idée...
a.k.a
Anonyme
eccéité est la propriété de ne pas être le même, cela même si les manifestations étaient parfaitement identiques : deux particules qu'on ne peut pas différencier ne sont pourtant pas la même particule. C'est ce genre de propriété l'eccéité, mais pour les personnes.
a.k.a
eccéité est la propriété de ne pas être le même
Donc eccéité c'est presque la même chose qu'identité ?
Alx33
vous pouvez en trouvez d'autre ici
Quand je conduis pas j'ai peur.
Anonyme
a.k.a
Mot du jour (attesté chez Rabelais 1558 - j'adore) :
OPIME, adj.
A. − HIST. ROMAINE. Dépouilles opimes. V. dépouille1.
B. − Littér. Riche, opulent, admirable. Et d'opimes joyaux, même dans la décade, Couverte tu seras comme un riche coursier. Dors, mon bon poignard, dors, vieux compagnon fidèle (Borel, Champavert, 1832, p.43).Byron, dans mon expérience et dans ma production, aura figuré l'exemple majeur, opime, de ces situations où (...) je donne le change (Du Bos, Journal, 1928, p.203).
Prononc. et Orth.: [ɔpim]. Ac. 1762-1935: opimes, adj. fém. plur. (v. aussi Littré, Rob.). Étymol. et Hist. a) 1558 «fertile, riche» (Epistre du Lymosin ds OEuvres de Rabelais, éd. Marty-Laveaux, t. 3, p.276 et p.278) attest. isolées, à nouv. au xixes. «riche, opulent» (Mercier Néol. 1801 p.154); b) 1571 dépouilles opimes (Gohory, Trad. d'Amadis, 152 b, livre XIII d'apr. Vaganay ds Fr. mod. t.6, p.64). Empr. au lat. opimus (de ops, opis «pouvoir; richesse») «fécond, fertile; riche; opulent» et dans l'expr. spolia opima «dépouilles opimes, butin remporté par le général romain qui avait tué de sa propre main le général ennemi». Fréq. abs. littér.: 23.
Anonyme
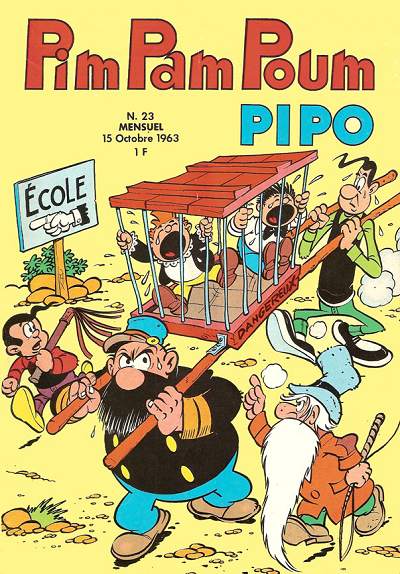
baissetagaineberthe
Chantal sent donc le moisi et le renfermé. Qui se porte volontaire pour aérer?
Non à la discrimination des chiens laids.
- < Liste des sujets
- Charte
