Philosophie sur le zinc !
- 1 072 réponses
- 43 participants
- 44 828 vues
- 25 followers
Anonyme
Philosophie sur le zinc !
Patron, vous m’en remettez-une, siouplaît…
Tu kiffes cogiter sur des questions dont la plupart des gens se foutent, sache que tu n’es pas seul au monde…
Tu mates sur ARTE les émissions de Raphaël Enthoven… tu es abonné à Sciences humaines, Philosophie magazine, ou Esprit, voire les trois,
T’aimes les sciences humaines : la sociologie, la psychologie - voire la psychologie sociale,la philosophie des sciences, l’art, la comparaison des systèmes culturels, la spiritualité,
Ma philosophie d'Amel Bent est le morceau qui arrive en premier sur ta playlist,
Tu passes ton bac,
Que tu sois camusien ou sartien,
Prends une chaise et un verre ….
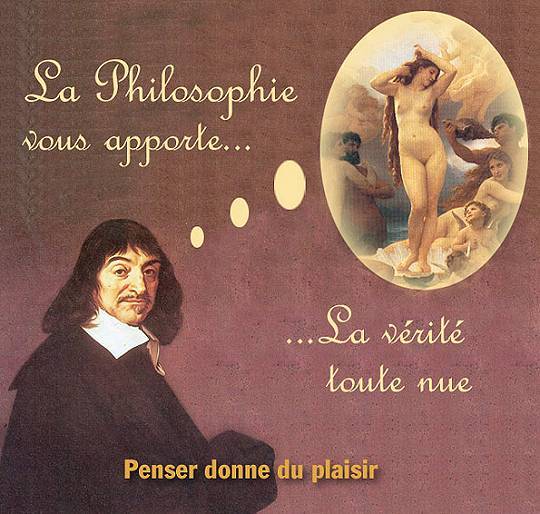
[ Dernière édition du message le 16/11/2013 à 12:54:42 ]
Anonyme
Citation :Ludwigh : tu ne m'aimes pas et je ne t'aime pas. Si nous évitions simplement de nous parler ? Si t'es ok, je te promets de te rendre la politesse... et je te présente mes excuses.
Faisons ainsi, comme des gentlemen
oryjen
Moi non plus je n'aime pas la psychanalyse freudienne, et j'ai déjà expliqué pourquoi. Cependant, ce que je déteste surtout là-dedans c'est la tentative permanente de noyer le poisson en utilisant un jargon ultra-spécialisé que n'entendent principalement que les usagers réguliers de la chose, et qui, en effet, n'a pas sa place dans une discussion philosophique. La philosophie concerne essentiellement l'expérience humaine ordinaire, voire même, pourrait-on dire, l'expérience humaine "moyenne", et se doit donc de faire l'effort de s'énoncer dans un langage le plus proche possible du langage courant. (ce n'est que mon avis)
Cependant, par rapport à leurs premières interventions, je note que les tenants de l'approche psychanalytique ont fait beaucoup d'efforts pour adapter leur discours, et il me semble que depuis plusieurs pages leurs interventions collent bien au débat. Il me semble donc normal d'entretenir avec eux la discussion comme avec n'importe qui, dans ce cadre strict.
A propos du livre de Damasio, je voudrais apporter une précision:
je note une observation contradictoire dans l'écrit de Damasio
C'est peut-être dans mon récit de lecture que se trouve la contradiction. J'ai lu ce bouquin il y a de nombreuses années. J'ai fait un condensé de mémoire lointaine, et je ne peux garantir la fidélité absolue au propos de l'auteur. On m'avait prié de dire "deux mots" à ce sujet, ce que je me suis efforcé de faire. D'autre part j'ai récemment prêté ce livre à ma fille qui est en Psycho à Nîmes, car, comme il arrive souvent aux bipèdes verticaux, certains sujets se signalent avec insistance à notre attention dans certaines périodes. Certains (ceux qui savent réellement ce qui se trouve derrière la porte que les psychanalystes ont peureusement entrouverte) appellent cela "synchronie".
Nous en avons donc parlé à Noël, comme elle était là et que nous discutions de ses études, et l'affaire m'est revenue en mémoire. J'ai retrouvé le livre, le lui ai passé, et elle l'a emporté. Quelques jours plus tard, voilà que Descartes arrive faire son petit tour ici.
Bref, je ne peux pas pour l'instant me rafraîchir la mémoire à ce sujet. Le mieux, pour l'exactitude des débats, serait de vous le procurer et de le lire vous-mêmes (éditions Odile Jacob, s'il n'est pas épuisé).
A mon avis, il serait d'ailleurs intéressant au plus haut point que tous ceux qui l'ont lu tentent d'en faire ici un petit résumé comme le mien. Cela nous permettrait certainement de comprendre et de dépasser un certain nombre de "problèmes".
Pour revenir à la psychanalyse (d'un point de vue philosophique évidemment), je trouve qu'on ne parle jamais de celui qui est allé le plus loin derrière la porte: C.G. Jung, et je me demande pourquoi...
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
Anonyme
Il y a peut-être aussi, du peu que j'ai lu, une certaine notion/vision du sacré qui peut être effrayante aux yeux d'une certaine forme de positivisme scientifique, là où Freud semblait se réclamer d'une approche scientifique, ce qui par certains égards est toujours plus rassurant pour certains dans un siècle ou la "modernité" était en marche et que ces "certains" en étaient les tenants.
Je dis ça avec le peu de fondement que je peux avoir sur la question mais qui me sortent là en écrivant.
oryjen
un modèle modulaire ou plutôt "holiste": mais s'il est adepte de la modularité
Quelques explications à ce sujet (j'ignore totalement)?
Pour Damasio, que je ne connais pas bien non plus, n'ayant lu qu'un seul ouvrage conseillé à l'époque par mon père, passionné des questions d'apprentissage, il semble défendre l'idée dans cet essai assez difficile (que j'ai peut-être mal compris) qu'on ne peut pas séparer les différents domaines de la conscience, ou de l'être: Du point de vue neurologique, et là à l'époque il avance des découvertes récentes occasionnées par ses travaux, tous les domaines sont imbriqués, jusqu'à un certain point. L'essentiel de ses découvertes concernent la collaboration étroite de différentes zones pour un grand nombre de tâches, ressortant de domaines variés (intellect, émotions, physiologie...), que l'on pensait jusqu'alors complètement séparées.
Ainsi il prouve que la mise en mémoire des états corporels est étroitement liée aux émotions, au fonctionnement social, et à tous les autres processus de mémoire, quel que soit leur domaine, à l'exception bizarre des manipulations intellectuelles pures.
Je crois me rappeler que chez Phineas Gadge, le déclin de sa "présence au monde" a été accompagné aussi par un déclin des performances intellectuelles à partir d'un certain stade, mais je ne me rappelle plus si Damasio en explique la raison.
Tout ceci étant dit, je signale que le nouquin était paru dans les années 90 et que pas mal d'eau a coulé sous les ponts depuis... Il serait intéressant aussi de consulter des publications récentes d'Antonio R. Damasio...
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
[ Dernière édition du message le 03/01/2014 à 13:39:58 ]
Anonyme
A mon avis, Michel Cazenave ( "spécialiste" de J ) résume le "problème de sa réception" lorsqu'il dit qu'il est suspecté "de mysticisme, quand on ne parle pas franchement de magie."
Son concept "d'archétype" est intéressant.
Sa brouille avec "Le Maître" Freud n'a pas dû l'aider.
Il a eu aussi de bons détracteurs... à un époque accusé de sympathie pour les nazis. Contredit par d'autres travaux critiques par la suite, mais ça fait une bonne casserole..
Tiens et d'ailleurs...en parlant de Lacan
"La seconde génération de psychanalystes freudiens, représentée par Donald Woods Winnicott ou Jacques Lacan par exemple, perpétuent la critique, faisant encore aujourd'hui de Jung une persona non grata en psychanalyse"
Simon De Talbert
Damasio c'est de la neurobiologie complétement dépassée; il est bien évident qu'une lésion fronto-temporale ça ne donne pas une atteinte motrice, ni ne perturbe un test de QI ; par contre la personne peut ne plus avoir d'affect, plus de sens moral, d'empathie, de mémoire sensorielle. tous les neurologues vous le dirons
c'est pas avec quelques vieux machins comme ça qu'on fait de la philosophie. ![]()
la psychanalyse avait montré depuis longtemps que les développements intellectuels sont liés à l'affectivité; vous voulez de la neuroscience: tient ben en vla et d'la bonne , de la récente: la découverte des "neurones-miroirs" montre le lien entre l'observation et l'action: c'est en regardant quelqu'un lire par exemple que j'apprends à lire, cela par l'intervention de ces neurones récemment découverts.
"Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible" M. TWAIN
[ Dernière édition du message le 03/01/2014 à 14:29:30 ]
Anonyme
de la récente: la découverte des "neurones-miroirs"
C'est pas tout frais non plus apparemment...
En 1996, Giacomo Rizzolatti, neurologue de l’Université de Parme, fit la surprenante découverte des neurones miroirs. Une découverte qui, bien que très peu connue du grand public, pourrait être à l’origine d’une révolution scientifique majeure dont on ne pressent que quelques contours.
oryjen
Un petit extrait de la page Wiki, pour alimenter la discussion:
Selon le psychiatre suisse Carl Gustav Jung (1875–1961), créateur du concept, l'inconscient collectif constitue « une condition ou une base de la psyché en soi, condition omniprésente, immuable, identique à elle-même en tous lieux »D 1. Toujours selon lui,
« les instincts et les archétypes constituent l'ensemble de l’inconscient collectif. Je l’appelle "collectif" parce que, au contraire de l’inconscient personnel, il n’est pas fait de contenus individuels plus ou moins uniques ne se reproduisant pas, mais de contenus qui sont universels et qui apparaissent régulièrementD 2. »
Jung donne en effet l'épithète de « collectif » à cette partie transpersonnelle de la psyché inconsciente, car ces matériaux se distinguent par leur récurrence d'apparition dans l'histoire humaine et parce qu'ils se manifestent au moyen des archétypes, autre concept central de la psychologie analytique.
Si pour Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, l'inconscient se caractérise avant tout par le fait qu'il naît du refoulement des pulsions, pour Jung, au contraire, l'inconscient est constitué de tout ce qui n'est pas conscient. Selon ce dernier :
« Il est inhérent à la réalité et la communication du conscient et de l'inconscient [et] permet le devenir de l'individu1. »
L'inconscient collectif et le conscient forment par conséquent, dans cette vision, un « ensemble [qui] constitue la totalité psychique dont nul élément ne peut disparaître sans dommage pour l'individuA 1. » Il aurait par ailleurs une fonction vitale pour l'homme, notamment exerçant une activité compensatrice au Moi. Il serait enfin la source du renouveau de l'être, par la compréhension des rêves et le travail de l'individuation.
Pour Jung, reconnaître l'existence et l'influence de l'inconscient collectif, c'est reconnaître que « nous ne sommes pas d'aujourd'hui ni d'hier ; nous sommes d'un âge immense2. »
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
[ Dernière édition du message le 03/01/2014 à 15:01:54 ]
oryjen
il est bien évident qu'une lésion fronto-temporale ça ne donne pas une atteinte motrice, ni ne perturbe un test de QI ; par contre la personne peut ne plus avoir d'affect, plus de sens moral, d'empathie, de mémoire sensorielle. tous les neurologues vous le dirons
c'est pas avec quelques vieux machins comme ça qu'on fait de la philosophie. redface2
Voyons, si tout le monde le sait, il s'agit donc d'une information vraie. Nous pouvons donc faire de la philosophie avec...
N'y aurait-il pas ici une sorte de... contradiction?

Blague à part, je n'ai jamais prétendu avoir "découvert" tout seul un auteur original et tout et tout... Je ne faisais, avec Damasio, dont je me rappelais avoir fait une lecture ébahie en tant qu'ignare en fait de neurosciences, qu'apporter modestement un peu d'eau à un moulin qui tournait déjà fort bien (Descartes, etc...).
Ce tackle était donc inutile et fort mal venu.
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
Anonyme
L'autre moi-même
Les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions ( 2010 )
http://www.franceinter.fr/sites/default/files/2011/07/05/86099/imagepage/lautre-moi-meme-les-nouvelles-cartes-du-cerveau-de-la-conscience-et.jpeg
« Mon âme est un orchestre caché, écrivait le poète Fernando Pessoa. Je ne me connais que comme symphonie. » D'où vient donc cette musique si particulière qui se joue en nous et nous accompagne à chaque moment ? D'où vient que nous soyons des êtres conscients, éprouvant toujours, dès que nous ouvrons les yeux et quoi que nous fassions, le sentiment inébranlable d'être toujours les mêmes ? Et quels sont, au tréfonds de nos cellules, les mécanismes qui permettent l'émergence de ce qu'il y a de plus humain en nous, nos sentiments, nos pensées, nos créations ?
Antonio Damasio, l'un des spécialistes des neurosciences les plus importants et les plus originaux, lève ici le voile sur la fabrique de la conscience. Au sein du cerveau, bien sûr, et qui plus est dans ses parties les plus profondes, si intimement liées au corps et à la régulation de la vie biologique.
Non, la conscience et le soi ne sont pas une « chose », une « substance », une « entité » en nous, comme on l'a longtemps postulé. Bien au contraire, ils forment un ensemble dynamique de processus nés petit à petit au fil de l'évolution biologique. Pour autant, les « naturaliser » ainsi, est-ce rabaisser l'homme ? Sûrement pas, pour Antonio Damasio, tant on peut s'émerveiller de la mécanique rendant possible la symphonie dont, à chaque instant de notre vie, nous sommes le chef d'orchestre.
Une approche très originale, qui renouvelle en profondeur la science de la conscience."
oryjen
- La conscience est une émanation d'un autre "lieu" qui habite les corps.
- La conscience est le résultat subjectif d'un ensemble complexe de causes biologiques objectives.
On rapporte que les indiens d'Amérique, voyant passer les premiers trains, étaient persuadés que les locomotives étaient des animaux mystérieux qui se mouvaient selon leur propre volonté.
On raconte aussi que quand on leur a présenté les premières images télévisées qu'ils aient jamais vues, sur des postes portatifs, des indigènes d'Amérique du Sud essayaient de saisir par-derrière le poste les petits bonshommes qu'ils voyaient vivre dedans.
Ne peut-on retourner la proposition et considérer que l'on peut, ou qu'on pourra un jour, décortiquer un être vivant pour comprendre comment il fonctionne, de même que l'on peut décortiquer et comprendre en détails un téléviseur?
Mais peut-on comprendre totalement le téléviseur sans comprendre aussi qui émet, et comment? De même, pourquoi le fait de comprendre comment fonctionnent les organes d'un corps vivant, serait-ce dans la plus infime synergie, suffirait-il à affirmer qu'il n'existe aucun émetteur nulle part?
Existe-t-il le moindre élément scientifique déterminant, aujourd'hui, qui permette d'affirmer que ce par quoi la conscience se manifeste en est aussi le lieu, le siège, et la seule origine?
Voilà pourquoi la perspective inaugurée par Jung me semble ouverte et toujours questionnante, alors que celle de Freud, Lacan et compagnie est devenu un dogme inapte à produire le moindre sens.
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
Anonyme
Anonyme
là comme ça, je dirais, la capacité à se penser pendant que l'on est, savoir ce que l'on fait ainsi que la réflexion qui en est la cause... une sorte de miroir à la fois de moi agissant dans le monde, et de moi pensant en dedans.
oryjen
Dans le fait de la conscience, il y a aussi cette étrangeté qu'il y a à se reconnaître soi-même chaque matin, jour après jour, ce "goût" dont sont teintées toutes nos perceptions...
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
Anonyme
Le thème de l'"éveil à soi" est apparu dans l'œuvre de Nishida en 1917 et a été approfondi jusqu'en 1945. Il a été développé par Nishida afin, précisément, de prendre le contrepied de l'épistémologie de son époque.
En effet, l'éveil à soi (jikaku) n'est pas la conscience de soi (jiko ishiki) (qu'il s'agisse de sa conception traditionnelle ou de sa reprise par Kant en tant qu'égo transcendantal ou par Husserl en tant que conscience éidétique). Nishida fait clairement la distinction entre les deux termes. En réalité, l'éveil à soi débute là où la conscience de soi atteint ses limites. Intrinsèquement relié à la recherche de la véritable réalité et du véritable soi, il se présente comme un nouveau point de départ de la philosophie.
La notion d'éveil à soi est commune aux six essais de Nishida que comporte L'Éveil à soi. Dans le premier essai, "Le temporel et l'intemporel", l'éveil à soi est inséparablement lié à la question du temps.
Les deux essais suivant, à savoir "Amour de soi, amour de l'autre et dialectique", ainsi que "Je et tu", ajoutent à la question de la temporalité celle des relations interpersonnelles. L'éveil à soi y est présenté comme le mode privilégié de la relation à l'autre.
Autrement dit, l'identité personnelle du "je" ne provient pas de lui-même mais du "tu" avec lequel il est en relation. Ici, l'éveil à soi n'est pas une conscience de soi mais un accès à soi médiatisé par le rapport au "tu". Ce même type de rapport se retrace dans l'essai "L'auto-identité absolument contradictoire", dans le cas cette fois des rapports entre l'individu et son milieu, notamment. L'un n'existe jamais sans l'autre, et inversement. De leurs relations sous le mode de l'éveil à soi naissent le monde de la réalité et l'histoire.
Enfin, les deux derniers essais présentés dans L'Éveil à soi ont pour titre "L'éveil à soi" et "À propos de la philosophie de Descartes". Rédigés respectivement en 1943 et 1944, ces essais sont déterminants pour comprendre la notion d'éveil à soi. Leurs contenus sont très semblables et débutent par une reprise et une remise en question du "je pense donc je suis" de Descartes. Il y est montré que le véritable éveil à soi est celui du soi individuel.
Ce dernier s'éveille à soi-même dans la mesure où il se situe dans le monde historique et dans la mesure où il entre en rapport avec la société. En concevant de cette manière le soi à partir du monde (et non pas le monde à partir du soi, comme c'est le cas avec la conscience de soi), Nishida combine directement l'éveil à soi au monde historique et l'élève au statut de forme fondamentale de la réalité.
Extrait de
http://www.japonline.com/jfra/eterv/tremblay.asp
oryjen
Repensant à cette question de définition de la conscience, je me disais qu'en fait on peut parfaitement éviter tous les objectifs et qualificatifs.
On doit pouvoir parler de conscience dès qu'il est question du rapport (de quelque ordre que ce soit) de soi-même (quoi que ce soit) à quoi que ce soit (y compris soi-même, ou un "autre", même informulé).
Cette définition permettrait de coller avec tous les phénomènes observés mais non pris en compte par les théories philosophiques ou cognitives. Il apparaît alors que la conscience habite probablement tous les vivants, et non pas seulement les bipèdes verticaux, même si elle s'exprime selon des modalités différentes.
D'ailleurs, et je ne crois pas qu'il en ait été fait écho ici, la bombe a éclaté cet été à propos des végétaux...
La relation qui en est faite d'un point de vue, disons "prudent":
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3557#.UsfPMPsg3pc
Un point de vue plus sympathisant et plus précis au niveau scientifique:
http://lejournaldeschouettessavantes.cafe-sciences.org/
Une perspective intéressante:
https://www.vedanta.asso.fr/note2.htm
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
[ Dernière édition du message le 04/01/2014 à 12:59:18 ]
oryjen
Je me demande, et j'aimerais bien savoir avec précision comment les scientifiques le font, comment on peut trancher clairement entre ces deux options classiques:
- La conscience est une émanation d'un autre "lieu" qui habite les corps.
- La conscience est le résultat subjectif d'un ensemble complexe de causes biologiques objectives.
Il existe peut-être des infos qui tranchent la question de manière propre et nette, et que j'ignore (pas trop versé dans les neurosciences).
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
quantat
Pour ta question les philosophes analytiques tentent des hypothèses...
Pour les neurosciences, la question de la conscience semble sortir de leur champ/domaine.
Il existe des neurobiologistes qui tentent des interprétations des données que leurs livrent leurs observations, mais ce que j'ai pu en lire était plutôt.... hum....pas toujours très rigoureux : tu peux te tourner vers JP Changeux ("l'homme neuronal" ou son dialogue avec Paul Ricoeur ; je crois que c'est "la nature et la règle").
Dans une autre voie, le témoignage d'Helen Keller (sourde, aveugle et muette) peut te donner une belle illustration de la façon dont la conscience se développe à mesure qu'elle apprend le langage.
oryjen
Pour les neurosciences, la question de la conscience semble sortir de leur champ/domaine.
Ca c'est ballot!
J'ai lu L'Homme Neuronal. Pas trop de rapport avec ma question....
Je crois qu'elle était mal posée, je vais m'y prendre autrement.
Supposons que je sois un gros allumé bien newage comme il faut, que je débarque à l'académie des sciences, et que je beugle: "Voyez, en fait le cerveau n'est ni la cause, ni le siège de la conscience. Il s'agit en fait d'un transmetteur interdimensionnel ultra-sophistiqué, qui assure depuis "là-bas" le pilotage des corps et le prélèvement des données sensibles et subjectives. Vous êtes tous des ignares."
Que va-t-on m'opposer de scientifique pour réfuter mes propos?
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
Anonyme
[ Dernière édition du message le 11/01/2014 à 21:37:03 ]
Anonyme
Par qui? Dans quel but?
Extrait d'une interview:
Marc Menant : On pourrait penser, dans la logique de la physique quantique – tiens je prend la place d’Alain Cirou d’un seul coup – qu’il y a une sorte de projection et que ce que nous percevions soit plus une image de quelque chose se situant ailleurs. Est-ce que çà c’est recevable ?
Jacques Vallée : C’est recevable. On peut supposer… On a déjà dans notre arsenal des hologrammes, des hologrammes qu’on peut projeter. Ca, on a vu… à Hollywood mais ils sont aussi utilisés dans la guerre psychologique. On peut projeter des images, on peut projeter des objets, mais ils ne seront pas matériels.
http://skystars.unblog.fr/2009/03/15/ovni-interview-de-jacques-vallee-par-marc-menant-europe-1/
Il en parle plus en détail dans un ses livres mais je ne sais plus lequel.
Pour ce qui me concerne Jacques Vallée est probablement un des ufologues les plus intéressants avec une méthodologie qui tient la route.
[ Dernière édition du message le 11/01/2014 à 21:44:51 ]
oryjen
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
oryjen

--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
Anonyme
Tu veux pas faire une répet' ici question de faire un rodage?
oryjen
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
- < Liste des sujets
- Charte
