Philosophie sur le zinc !
- 1 072 réponses
- 43 participants
- 44 808 vues
- 25 followers
Anonyme
Philosophie sur le zinc !
Patron, vous m’en remettez-une, siouplaît…
Tu kiffes cogiter sur des questions dont la plupart des gens se foutent, sache que tu n’es pas seul au monde…
Tu mates sur ARTE les émissions de Raphaël Enthoven… tu es abonné à Sciences humaines, Philosophie magazine, ou Esprit, voire les trois,
T’aimes les sciences humaines : la sociologie, la psychologie - voire la psychologie sociale,la philosophie des sciences, l’art, la comparaison des systèmes culturels, la spiritualité,
Ma philosophie d'Amel Bent est le morceau qui arrive en premier sur ta playlist,
Tu passes ton bac,
Que tu sois camusien ou sartien,
Prends une chaise et un verre ….
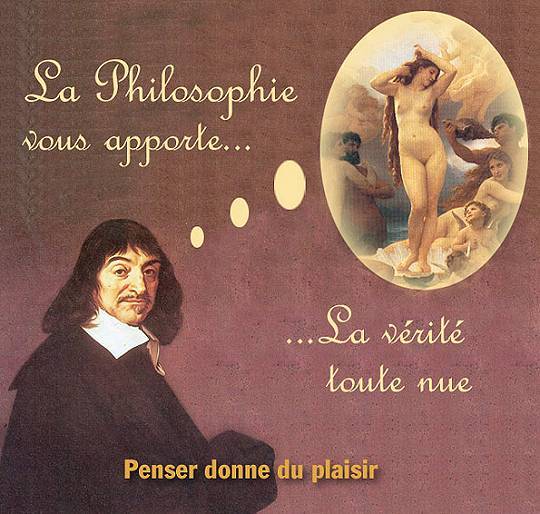
[ Dernière édition du message le 16/11/2013 à 12:54:42 ]
Anonyme
L'unité de la pensée indienne. Entretien avec Michel Hulin ("Spécialiste de l'hindouisme" )
Sciences Humaines : Existe-t-il une philosophie indienne comparable à la philosophie occidentale ?
Michel Hulin : Il y a encore vingt-cinq ans, la notion de philosophie indienne était problématique. On restait tributaire de la thèse de Heidegger selon laquelle la philosophie était une voie intellectuelle typiquement occidentale ; née en Grèce, elle s'était déployée aux temps modernes à travers un discours rationnel et les catégories de la métaphysique.
Heidegger lui-même n'avait pas de contacts directs avec les pensées orientales. Il ne connaissait qu'indirectement les pensées d'Extrême-Orient, de Chine et du Japon, pensées qui semblent échapper totalement à notre vision du monde, à notre langue, à nos catégories mentales. Cela pouvait passer pour de la non-philosophie.
L'Inde, elle, occupe une position médiane entre l'Extrême-Orient et l'Occident. Le sanskrit et le grec possèdent des liens de parenté : ce sont toutes deux des langues indo-européennes. La traduction en a été plus aisée. La pensée indienne a fait l'objet d'une découverte récente en Occident. Il existe un très riche corpus de textes. En 1983, K. Porter recensait 6 000 titres dans la production philosophique indienne et orientale, essentiellement écrits en sanskrit. Aujourd'hui, on n'hésite plus à admettre l'existence d'une authentique philosophie indienne, dont on connaît de mieux en mieux l'histoire et les riches développements.
Quelle est la nature profonde de cette philosophie ?
Au début, dans la Haute Antiquité, la pensée indienne qui s'exprime dans les Veda est essentiellement de nature religieuse. Par la suite se sont développés autour des Veda des courants de pensées plus spéculatifs, à caractères philosophique et métaphysique. L'hindouisme a donné naissance à une grande diversité de spéculations philosophiques que l'on regroupe généralement sous le nom de darshanas (ou « points de vue »).
Cette pensée indienne est restée très imprégnée de logique et de linguistique. La formation intellectuelle brahmanique passait par la grammaire et la logique. Cette tradition grammaticale et linguistique est la plus vieille du monde. Ainsi, dès le ive siècle av. J.-C., Pãnini a proposé une première description linguistique du sanskrit.
Puis la coexistence des écoles bouddhiques et brahmaniques a conduit à développer le débat d'idées, et cela a donné naissance à un art du dialogue très sophistiqué. A partir de là se sont développés des outils logiques très raffinés visant à l'administration rationnelle de la preuve.
Pourtant, la pensée indienne se construit en référence permanente à des textes sacrés. Cette attitude semble en contradiction avec un esprit purement rationaliste.
Dans la pensée indienne, il y a eu coexistence entre la référence à la tradition (les textes des Veda) et le développement d'une pensée rationnelle autonome. Au fond, il en va de même pour la scolastique médiévale en Occident.
Mais il y a cependant une grande différence dans la finalité. La pensée indienne ne se conçoit pas comme une quête d'une vérité accessible uniquement par le débat ou l'argumentation rationnelle. Si les Grecs pensaient parvenir à bout des erreurs et des illusions par le dialogue ou la démonstration, du côté indien, le pessimisme est plus profond quant à l'aptitude à exprimer la Vérité à travers le langage.
Quelle que soit l'époque ou l'école de pensée, il y a une profonde unité de la pensée indienne visant à un seul projet : le nirvana ou moksha, la fin du cycle des renaissances (samsâra), un idéal mystique qui se situe au-delà des mots.
Le but suprême de la philosophie indienne réside dans une quête spirituelle et existentielle qui débouche sur le silence. Un silence qui n'est pas signe d'ignorance, mais une certaine façon de vivre le monde. Shankara, le plus grand philosophe de la tradition mystique hindoue, qui a vécu au viiie siècle, exprimait le but suprême de la philosophie à travers la notion de « non-dualité », état qui ne peut être atteint que par une discipline à la fois spirituelle, corporelle, morale... et non par la seule voie des concepts.
Et un autre article sur la "pensée chinoise" de Jf Dortier
L'oeuvre de François Jullien : la pensée chinoise comme miroir de l'Occident ?
Toute l'oeuvre, déjà imposante, de François Jullien est construite comme un jeu de miroir entre la pensée chinoise et la pensée occidentale. L'exploration de la pensée chinoise est conçue comme une sorte de détour par une « pensée du dehors », radicalement « autre », qui permet de mettre en relief notre propre mode de pensée.
Dans Procès ou Création. Une introduction à la pensée chinoise (Seuil, 1989), F. Jullien montrait combien, dans la pensée chinoise, la réalité est conçue comme un processus continu, en transformation permanente, et non comme un ensemble d'éléments séparés et distincts. La pensée chinoise est une pensée relationnelle.
Le Sage est sans idée ou l'Autre de la philosophie (Seuil, 1998) présente une vision de la quête philosophique autre que celle qui prévaut en Occident. Pour la pensée chinoise, le sage ne vise pas à bâtir un système conceptuel, cohérent et replié sur lui-même. Le sage est celui qui est « sans idée » : une absence d'idée qui n'est pas du scepticisme (« rien n'est vrai »), ni du relativisme (« tout est un peu vrai »), mais une forme de disponibilité de la pensée et d'ouverture au monde.
Dans Le Détour et l'Accès. Stratégies du sens en Chine, en Grèce (LGF, 1997), F. Jullien veut rendre compte de la manière dont la pensée chinoise privilégie l'allusion et l'expression détournées à la formule qui chercherait à coller au plus près du sens, comme le veut la tradition de pensée occidentale. Penser d'un dehors (la Chine) (Seuil, 2000) est un livre d'entretiens qui présente l'itinéraire intellectuel de F. Jullien.
a.k.a
Et de la philo japonaise, à écouter : https://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance-philosophie-japonaise-l-ecole-de-kyoto-2013-11-15
oryjen
et nous faire retourner à l'antiquité
C'est le contraire de ce que je dis. L'antiquité elle aussi était encombrée de sophistes, entre autres.
de dire beaucoup de conneries
Oui? Par exemple?
je voulais surtout te demander ce que tu pensais des neurosciences et de la démarche de quelqu'un comme Oliver Sacks, par exemple.
Connais pas. Je vais aller voir ça.
Prouve cette thèse.
Je n'en ai nullement l'intention. Je me contenterai de signaler le fait. Fais tout ce que tu dois faire pour accéder au sens profond du Jardin de Roses de Saadi par exemple, et ta demande n'aura plus aucun sens.
de L'Inconnu.. qui construisent leur discours dans un no man's land métaphysique.. c'est le champ de tous les possibles vu que rien n'y est vérifiable.
Foin de cet engouement new age pour le vague et grand "inconnu"... Je ne parle que de choses vérifiables. Mais je ne ferai pas le chemin à ta place. J'ai déjà le mien à parcourir, et ça suffit.
des millions de gens sur cette terre mènent une vie à peu près stable grâce à cet "arsenal chimique"
Tu ne parles ici que de leur vie sociale, évidemment. Oui la vitrine est à peu près propre, grâce à Prozac. Merci Prozac. Mais c'est une glace sans tain. Heureusement, on ne peut pas voir le merdier au-dedans. Mais ce n'est pas du domaine du social, donc on s'en tape, nesspa? Nous parlons d'estropiés, là. C'est ennuyeux... pour eux.
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
[ Dernière édition du message le 11/12/2013 à 23:29:23 ]
Anonyme
Citation :
Merci Prozac. Mais c'est une glace sans tain. Heureusement, on ne peut pas voir le merdier au-dedans. Mais ce n'est pas du domaine du social, donc on s'en tape, nesspa?
non, je connais des gens qui prennent ou ont pris des médocs parce que ça leur fait du bien.
Ton discours est irresponsable. oui, des millions de gens ont une vie relativement stable qu'ils n'auraient pas sans médocs. certains n'auraient plus de vie du tout même.
oui, des victimes des médocs existent aussi. je me permets de faire remarquer que sans la rapacité des groupes pharmaceutiques, sans les prescriptions malhonnêtes de certains médecins, avec une agence du médicament réellement indépendante, ces médocs causeraient moins de dégâts.
en attendant, le discours anti-médocs est potentiellement criminel, vous avez oublié Hamer ?
oryjen
Mais en voilà assez.
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
Anonyme
Ryke Geerd Hamer, né 17 mai 1935 à Mettmann en Allemagne, ancien médecin très controversé, est l'inventeur de la nouvelle médecine germanique qui prétend guérir le cancer. Il a été condamné à 19 mois de prison en Allemagne en 1997 pour « exercice illégal de la médecine » et, après s'être réfugié quelque temps en Espagne, à trois ans de prison ferme en 2004 en France2 (il a bénéficié d'une libération conditionnelle en 2006).
En Autriche, Olivia Pilhar, 6 ans en 1995, est diagnostiquée avec une tumeur de Wilms. Ses parents consultent Hamer qui diagnostique pour sa part l'existence de « plusieurs conflits » et propose un traitement que les parents suivent. La santé de l'enfant se détériore, la tumeur grossit jusqu'à faire 4 kilos, ses chances de survie n'étaient plus évaluée qu'à 10 %9. Une cour de justice autrichienne exigea qu'un traitement conventionnel lui soit appliqué, avec chimiothérapie. L'enfant a survécu après ce traitement. Les parents ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis.
Hamer prétend que la chimiothérapie et la morphine seraient utilisées par une conspiration juive dans l'objectif d'un génocide de la population non juive1. De même, il explique le rejet de ses thèses et la révocation de son autorisation à exercer la médecine comme le résultat d'une conspiration juive.
oryjen
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
Anonyme
blah blah blah...
Citation :
Dans la plupart des cas les causes ne sont pas médicales.
preuves ?
Citation :
C'est que l'esprit, en réalité, ne fonctionne pas comme le pensent les psychiatres
ah bon ? et toi, tu sais comment ?
Citation :
Les causes sont souvent profondes, hors de portée du médical.
ce n'est pas parce que les causes sont profondes qu'elles sont hors de portée du médical (pourquoi du "médical" ?)
Citation :
c'est le pansement sur la jambe de bois
c'est faux.
arrête les prescriptions de médocs, et tu vas voir la vague d'homicides et de suicides.
Citation :
Mais en voilà assez.
prends un aspro, ça ira mieux.
Anonyme
vouloir entamer un dialogue sur cette base, c'est mal partir.
Anonyme
Pour aller un peu à la croisée des chemins, François Jullien a écrit un livre qui semble intéressant, que j'ai acquis et qui est sur ma pile des lectures à venir:
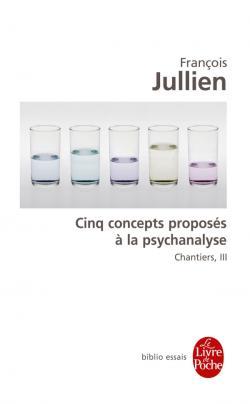
"En dépit de la révolution qu'il opère, Freud n'est-il pas demeuré dépendant de l'outillage intellectuel européen ? Ne laisse-t-il pas dans l'ombre, de ce fait, certains aspects de la pratique analytique que sa théorie n'a pu explorer ?
Mais comment s'en rendre compte, si ce n'est en sortant d'Europe ?
Je propose ici cinq concepts, abstraits de la pensée chinoise, dans lesquels ce qui se passe dans la cure pourrait se réfléchir et, peut-être, mieux s'expliciter. Chacun opère un décalage : la disponibilité par rapport à l'attention du psychanalyste ; l'allusivité par rapport au dire de l'analysant ; le biais par rapport à l'ambition de la méthode ; la dé-fixation par rapport à l'enjeu même de la cure ; la transformation silencieuse, enfin, par rapport à l'exigence de l'action et de son résultat.
Autant d'approches qui font découvrir la psychanalyse sous un jour oblique, la révélant dans son impensé. Or, cet impensé n'est-il pas aussi celui de la pensée européenne découverte dans ses partis pris ?
De quoi introduire également à la pensée chinoise dont ces notions, en venant sur le terrain de la psychanalyse, se remettent à travailler."
F. J.
a.k.a> merci pour le lien sur la philosophie japonaise.
J'ai vu le bouquin de chez Vrin et je tourne autour depuis quelques temps.
L'as-tu lu?
Personnellement je l'ai survolé et il me semblait proche des concepts produits par la philosophie occidentale.
Peut-être l'écoute de l'émission me permettra d'en savoir plus.
Simon De Talbert
Citation de orygen :
Tu ne parles ici que de leur vie sociale, évidemment. Oui la vitrine est à peu près propre, grâce à Prozac. Merci Prozac. Mais c'est une glace sans tain. Heureusement, on ne peut pas voir le merdier au-dedans. Mais ce n'est pas du domaine du social, donc on s'en tape, nesspa? Nous parlons d'estropiés, là. C'est ennuyeux... pour eux
pour ta gouverne, je t"informe que ce genre de médicament est en gros là pour corriger un déficit en sérotonine; ce déficit est responsable des symptômes dépressifs qui disparaissent sous traitement; ça n'empêche pas d'aborder la dépression sous l'angle du soin psychologique , de rechercher les causes personnelles, sociales, familiales et d'aider le patient. le médicament (qui est une sorte de correcteur d'un déficit en une substance naturelle ) est associé alors à la prise en charge psychologique.
tu vois là c'est le genre de grosse connerie que tu peux sortir et qui discrédite tes arguments (tu manie en fait de gros clichés-renseigne-toi avant de parler)
"Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible" M. TWAIN
Anonyme
Les darshanas ou darsanas sont les six points de vue doctrinaux orthodoxes de l'hindouisme.
On compte :
Le Nyâya, point de vue logique, dont la méthode est la dialectique,
Le Vaisheshika, point de vue physique et atomiste, dont la méthode est l'expérience des sens,
Le Sâmkhya, point de vue mathématique ou cosmologique, dont la méthode est la spéculation intellectuelle,
Le Yoga, point de vue psychologique ou psychique de l'identification qui est lié à la perception et à l'intuition du monde subtil et dont la méthode est le contrôle du mental, des sens et des facultés internes,
Le Mîmâmsâ, point de vue théologique et herméneutique de la réflexion, dont la méthode est l'étude des Écritures sacrées et de la révélation,
Le Vedanta, point de vue métaphysique, ou fin de connaissance, dont la méthode est la spéculation abstraite.
Anonyme
Merci
oryjen
Tu auras peut-être l'amabilité de bien vouloir te référer, pour me citer mes "conneries", à mes assertions précédentes, puisque c'était à leur lecture que tu avait sorti cette saillie...
Mais c'est agaçant, ici: Dans les discussions de fond, il semble que certains se soucient peu d'examiner les faits ou de rechercher le vrai. Il leur suffit de tâcher de discréditer l'adversaire, en lui prêtant des énormités qu'il n'a pas dites. C'est un procédé indigne, tout juste bon pour les empoignades politiques, qui n'a absolument pas sa place dans une discussion philosophique.
Je réitère donc ma demande: Cite moi quelques-unes des "conneries" que selon toi je passe mon temps à proférer, et nous verrons si nous pouvons faire avancer la discussion sur ces points précis.
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
a.k.a
Kumo > Super, je savais bien que ça intéresserait quelqu'un. Étonnant que ça soit toi... ![]()
Pour le livre, c'est un corpus de textes. Je ne l'ai pas lu mais ça me paraît être un bon début dans la philo japonaise : Vrin est une bonne maison et Dalissier m'a l'air solide. Je ne connais pas les autres co-auteurs.
Anonyme
Je ne l'ai pas lu mais ça me paraît être un bon début dans la philo japonaise : Vrin est une bonne maison et Dalissier m'a l'air solide. Je ne connais pas les autres co-auteurs.
Bon l'émission m'a définitivement convaincu d'acheter le bouquin.
En fait c'est une sorte de syncrétisme basée sur la phénoménologie occidentale (Husserl) passée par les filtres "conceptuels" traditionnelles japonaises (bouddhisme, shintoïsme, zen).
Du peu que j'en ai entendu Dalissier a effectivement l'air solide.
L'autre invité, Yasuhika Sugimura, était très intéressant car il n'a pas hésité à démonter quelques clichés
afin que les auditeurs n'aient pas une vision trop exotique des propos tenus par ces philosophes, sans pour autant
en négliger certains aspects typiques.
oryjen
Il y a aussi autre chose, dù à la traduction: Beaucoup de textes anciens et exotiques ont commencé à être traduits en langues occidentales au XIXe siècle (principalement l'anglais). Nous héritons aujourd'hui de ces traductions de référence, que nous devons à des gens qui ont fait le plus gros du travail: déchiffrage du texte et interprétation des idées. Les traductions suivantes commencent bien souvent par repartir de ces traductions de référence, et se contentent de remettre le vocabulaire et les tournures de phrase au goût de l'époque, et très rares sont ceux qui reprennent le travail à zéro. Or les premiers traducteurs étaient conditionnés par leur propre époque, qui les a conduits quelquefois à passer complètement à côté du sujet, au profit du verbiage universitaire en vogue à tel moment. On a ainsi hérité assez souvent de choses pompeuses absolument ridicules et vides de sens.
Ainsi, le Mathnavi de Rumi, qui dans le texte original contient beaucoup d'humour, de malice, de clins d'oeil, et même une bonne proportion d'expressions argotiques (nécessaires à un certain niveau d'apprentissage), est resté à peu près totalement hors de portée des traducteurs du XIXe qui ne connaissaient pas ces tournures de langage, et qui de toute manière, même s'ils les avaient connues, n'auraient jamais osé les coucher sur le papier du fait de leur conditionnement culturel.
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
[ Dernière édition du message le 13/12/2013 à 09:11:19 ]
Anonyme
une référence
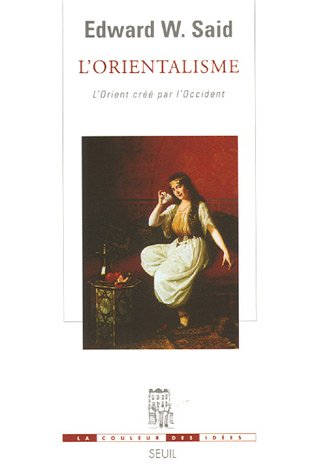
[ Dernière édition du message le 13/12/2013 à 18:24:07 ]
a.k.a
D'autant plus que je crois que ce sont des textes du XXe, ceux sur la philosophie japonaise, on est plus tranquilles en termes de rigueur de la traduction.
Anonyme
JOL : Quelles sont les principales difficultés liées à la traduction d'une œuvre philosophique japonaise ?
JT : La première de ces difficultés tient au vocabulaire. En effet, l'un des enjeux majeurs de l'introduction de la philosophie occidentale au Japon au début de l'ère Meiji a été celui de la création d'un vocabulaire philosophique. Un grand nombre des notions philosophiques étaient alors sans équivalent dans la langue japonaise. Il a donc fallu en créer, soit en utilisant les idéogrammes chinois, soit en forgeant des vocables nouveaux. Ce type de mots est calqué sur l'étymologie grecque ou latine. Ils sont la traduction des termes philosophiques occidentaux correspondants.
Il est donc facile de les retraduire en français. Le point délicat, cependant, est que leur signification est légèrement modifiée par rapport aux langues occidentales lorsqu'ils sont réutilisés dans un système philosophique, par exemple celui de Nishida. Il est alors nécessaire, en traduction, de viser non seulement la précision lexicale, mais surtout de resituer les mots dans leur contexte philosophique précis.
La seconde difficulté tient au type de traduction qu'on décide de produire. En effet, s'agit-il de traduire mot à mot le texte philosophique japonais, ou bien encore d'en synthétiser les idées principales dans un langage plus concis ? Ni l'un ni l'autre à mon avis. Car la traduction mot à mot fourni det simples équivalences lexicales et structures grammaticales, sans qu'il soit tenu compte du contexte et du sens du texte à traduire. Elle risque de produire une traduction inintelligible. Quant au type de traduction qui consiste à reconstruire le sens du texte japonais, il autorise la traductrice à intervenir dans un texte en son propre nom, avec tous les risques de contresens qu'un tel procédé implique.
En fait, tout dépend du type de texte à traduire. La traduction peut être un travail de routine s'accommodant du mot à mot (textes techniques, modes d'emploi) ou de la reconstruction (poésie, prose). Mais il en va différemment de textes philosophiques comme ceux de Nishida, où une grande précision est de rigueur. La pensée de Nishida étant extrêmement précise, j'ai jugé préférable de lui conserver ce caractère en m'en éloignant le moins possible, et en effectuant un travail de traduction et d'interprétation procédant par étapes successives.
Il importe désormais, de la part des traductrices et traducteurs, de viser d'abord et avant tout à produire des traductions - en langues occidentales ou autres - qui mettent l'accent sur la compréhension en profondeur de des textes japonais originaux sur la précision dans le choix de la terminologie, sans oublier pour autant la qualité du style littéraire de la traduction. Signalons en terminant qu'une plus grande ouverture d'esprit serait souhaitable de la part des maisons d'éditions; elle favoriserait la publication de non seulement ses œuvres de philosophie japonaise, mais également de types de pensées autres qu'européens ou américains.
Propos recueillis par Claude Leblanc
(2 mars 2004)
http://www.japonline.com/jfra/eterv/tremblay.asp
Un autre article en anglais sur la question de la traduction en français de Nishida Kitaro.
https://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/2061
Le bouquin de E.W.Said est effectivement
Il a eu une "réponse" que je n'ai pas encore lue mais qui traîne quelque part dans ma bibliothèque
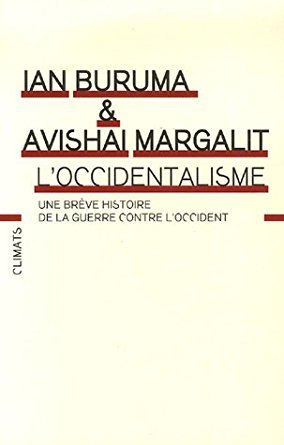
Anonyme
Citation :
la traduction mot à mot
j'ai une formation de traducteur. ce genre de pratique ne peut être le fait d'un traducteur digne de ce nom. il n'y a que les journalistes pour faire ça, avec les néologismes, barbarismes et faux amis en prime.
oryjen
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
Anonyme
j'ai une formation de traducteur. ce genre de pratique ne peut être le fait d'un traducteur digne de ce nom.
Tu parles de Jacinthe Tremblay?
Anonyme
Spécialiste de la philosophie japonaise, Jacynthe Tremblay a choisi de s'attarder sur le plus important des philosophes nippons du XXe siècle, Nishida Kitarô. Après lui avoir consacré une étude en 2000, elle publie la traduction de six essais du penseur que l'on présente souvent en Occident comme le chantre de l'ultranationalisme japonais pendant la Seconde guerre mondiale. Jacynthe Tremblay nous rappelle que Nishida mérite surtout d'être connu pour son œuvre philosophique et son apport dans la réflexion philosophique au Japon.
[quote]J'ai commencé à m'intéresser à la philosophie japonaise en 1989, au terme de mes études doctorales en philosophie de la religion à l'université de Montréal. Mon projet initial portait sur la question du néant dans la philosophie de Nishitani Keiji, un proche disciple de Nishida. En 1990, je me suis rendue au Japon pour un stage d'études d'une durée de deux ans. Or, mon superviseur de l'université de Tôkyô, Sakabe Megumi, m'a fortement incitée à lire au préalable des essais de Nishida en japonais. En me mettant à l'étude de cet auteur, j'ai éprouvé une telle fascination que j'ai laissé de côté mon projet sur Nishitani pour me concentrer uniquement sur Nishida. Ce qui m'a le plus attirée, c'est sa manière de remettre en question les modes de pensée habituels, sa capacité à repenser radicalement les questions philosophiques.
Il existait déjà au début des années 1990 quelques traductions anglaises de Nishida, notamment de ses premières œuvres. Je me suis toutefois efforcée de lire cet auteur uniquement en japonais, malgré les grandes difficultés que représentent son style écrit et son mode de pensée philosophique. À cause de cette option méthodologique, ma recherche a progressé assez lentement au début mais j'en ai tiré d'énormes avantages, surtout en ce qui concerne la compréhension en profondeur de l'œuvre de Nishida. En effet, ce dernier a développé sa pensée dans l'acte même d'écrire. Elle est inséparablement liée à la manière dont il a utilisé et, très souvent, déconstruit la langue japonaise afin de la rendre apte à exprimer des idées qui, pour une grande part d'entre elles, étaient nouvelles tant en regard de la philosophie occidentale que de la pensée japonaise traditionnelle.
Après mon retour au Canada en 1992, j'ai occupé un emploi de recherche au Centre d'études sur l'Asie de l'Est de l'université de Montréal. Cette recherche a été centrée sur Nishida et, de manière plus périphérique, sur Watsuji Tetsurô, éthicien bien connu au Japon. Depuis 1997, je vis de nouveau au Japon, occupée par la recherche sur Nishida, de même que par la traduction de parties de son œuvre. Ces différents travaux ont donné lieu à plusieurs articles, ainsi qu'à deux livres. Le premier est un petit ouvrage de vulgarisation traitant des rapports entre l'humain et le monde, de même que des rapports interpersonnels (La relation et son lieu. Introduction à la philosophie de la relation de Nishida, Beauport, MNH/anthropos, 2000, 78 p.). Le second porte sur la "logique du basho" (lieu) développée par Nishida (cf. Nishida Kitarô. Le Jeu de l'individuel et de l'universel, Paris, CNRS Editions, 2000). Trois de mes premiers essais de traduction de Nishida apparaissent en annexe de ce dernier livre.[/quote]
Anonyme
La seconde difficulté tient au type de traduction qu'on décide de produire. En effet, s'agit-il de traduire mot à mot le texte philosophique japonais, ou bien encore d'en synthétiser les idées principales dans un langage plus concis ? Ni l'un ni l'autre à mon avis. Car la traduction mot à mot fourni det simples équivalences lexicales et structures grammaticales, sans qu'il soit tenu compte du contexte et du sens du texte à traduire. Elle risque de produire une traduction inintelligible. Quant au type de traduction qui consiste à reconstruire le sens du texte japonais, il autorise la traductrice à intervenir dans un texte en son propre nom, avec tous les risques de contresens qu'un tel procédé implique.
- < Liste des sujets
- Charte
