Philosophie sur le zinc !
- 1 072 réponses
- 43 participants
- 44 813 vues
- 25 followers
Anonyme
Philosophie sur le zinc !
Patron, vous m’en remettez-une, siouplaît…
Tu kiffes cogiter sur des questions dont la plupart des gens se foutent, sache que tu n’es pas seul au monde…
Tu mates sur ARTE les émissions de Raphaël Enthoven… tu es abonné à Sciences humaines, Philosophie magazine, ou Esprit, voire les trois,
T’aimes les sciences humaines : la sociologie, la psychologie - voire la psychologie sociale,la philosophie des sciences, l’art, la comparaison des systèmes culturels, la spiritualité,
Ma philosophie d'Amel Bent est le morceau qui arrive en premier sur ta playlist,
Tu passes ton bac,
Que tu sois camusien ou sartien,
Prends une chaise et un verre ….
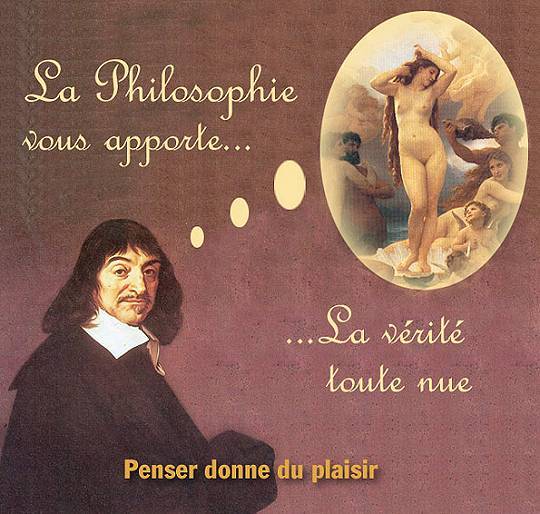
[ Dernière édition du message le 16/11/2013 à 12:54:42 ]
Anonyme
Lorenz ferait presque ici du Darwinisme appliqué à la culture.
Au sens de l'évolution des espèces, pour qu'il y ait spéciation (création d'une nouvelle espèce : disparition d'interfécondité), il faut plusieurs facteurs :
1. Une variabilité génétique au sein d'une population suffisamment grande.
2. Un "évènement" aboutissant à l'isolement (mécanique, climatique, éthologique, génétique) d'échantillons d'individus de cette population (climat, tectonique, migration, "essaimage", insularité, etc.).
3. Des conditions du milieu qui différent pour les populations ainsi isolées.
Ces sous-populations issues d'une population "mère", et soumises à des conditions du milieu qui différent, peuvent, via le jeu de la dérive génétique (mutation + brassage génétique) et de la sélection naturelle, ne plus pouvoir se reproduire entre elles et ainsi constituer des espèces distinctes.
Appliqué à la Culture, Lorenz dénoncerait ici l'homogénéisation de la variabilité culturelle du au fait que le monde soit "petit" pour homo sapiens... que l'isolement culturel n'existe plus.
Le brassage est trop important au sein de la population mère pour permettre l'isolement culturel d'un échantillon de la population.
La spéciation culturelle n'est plus possible.
[ Dernière édition du message le 26/08/2014 à 12:14:40 ]
Anonyme
pas mal du tout ! ceci dit le cloisonnement culturel entre générations et classes sociales ne doit pas être sousestimé. ce n'est pas parce que les moyens de communication se développent que les gens savent communiquer entre eux : leurs références restent différentes. par contre, je veux bien croire que les barrières entre Etats ne distinguent plus bcp les populations.
quantat
Citation de sobotonoj :
je veux bien croire que les barrières entre Etats ne distinguent plus bcp les populations.
Non, mais les barrières linguistiques sont encore loin de s'effondrer
oryjen
C'est-à-dire que les langues deviennent de plus en plus perméables à l'anglais vulgaire techno-économique.
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
Anonyme
Il suffit de regarder ce qui existait il y a juste un siècle ou deux... les patois régionaux étaient la norme.
Aujourd'hui tous les bretons parlent français, et tous ne parlent pas bretons.
quantat
Cette perméabilité à l'anglais techno économique (assez pénible, pour ce qu'elle révèle parfois de snobisme naïf) ne signifie pas du tout que les français sont prêts à tchater avec des british... on en est très loin... pour qu'un rapprochement réel entre peuples se produise il faut nécessairement une langue commune pratiquée dans le cadre de la vie courante...
Et je ne parle que de l'anglais... c'est pas franchement mieux avec les autres formes actuelles de latin (espagnol, catalan, italien, etc.) qui devraient pourtant nous être plus accessibles
[ Dernière édition du message le 26/08/2014 à 15:50:23 ]
Anonyme
Cette perméabilité à l'anglais techno économique (assez pénible, pour ce qu'elle révèle parfois de snobisme naïf) ne signifie pas du tout que les français sont prêts à tchater avec des british... on en est très loin...
A mon avis, c'est une vision... un peu étriquée.
Il faut voir cette évolution des personnes parlant Anglais dans le temps... pas au regard de notre propre génération.
Mon gamin de 6 ans compte déjà en anglais, et manipule des objets avec des boutons en anglais...
Dans 100/200 ans... plus personne ne se fera chier à traduire la moindre notice.
[ Dernière édition du message le 26/08/2014 à 16:09:52 ]
Anonyme
l'exemple que tu donnes est éloquent et te rapporte +1000.
samy dread
Non je ne mettrai pas de pull
Anonyme
La proportion de personne parlant Anglais, en France, aujourd'hui, est sans commune mesure avec ce qu'elle était il y a un siècle... et je gage que cette même proportion de personne parlant Anglais aujourd'hui est loin de ce qu'elle sera dans un siècle.
quantat
Comme dans 100 ans on sera tous morts.... Personnellement j'ai pas vu beaucoup de progrès en trente ans chez mes compatriotes (dans les pays étrangers où l'anglais domine pour les touristes)... c'est pourquoi j'ai de sérieux doutes...
oryjen
C'est vrai qu'au premier regard il semble y avoir une ressemblance frappante. Mais en regardant de plus près?
J'ai souvent eu le sentiment que tout système complexe se comportait à peu près toujours de la même manière, quelle que soit sa nature. Et je retrouve ici chez Lorenz une analyse précise et a priori brillante de ces mécanismes...
C'est une question intéressante, parce qu'il se joue ici une bonne partie de l'image exceptionnelle que l'espèce humaine se fait d'elle-même, du fait justement de ses "prérogatives culturelles". Et du coup, ce qu'elle s'autorise, comme de droit divin (matérialisme dialectique compris), vis-à-vis du reste de l'univers.
Mais si l'on peut démontrer que nos mécanismes culturels ne sont en rien coupés des processus universels, mais n'en sont qu'une autre forme d'expression adaptée au terrain "virtuel" de notre subjectivité individuelle ou sociale, beaucoup de nos comportements ne vont plus de soi et doivent être reconsidérés.
Cette question de la séparation ontologique de l'humain par rapport au monde "naturel" est centrale à toute philosophie, qu'elle soit ou non religieuse. Dans son acceptation, les progressistes sociaux emboîtent exactement le pas aux religieux, quoique selon des justifications différentes.
Lorenz, en prétendant démontrer scientifiquement, et de manière très convaincante, la parfaite continuité du subjectif humain par rapport à l'objectif biologique, ouvre une boîte de Pandore que tous les philosophes avant lui s'étaient efforcés de maintenir fermée en éludant cette question centrale.
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
[ Dernière édition du message le 27/08/2014 à 10:52:00 ]
quantat
Salut Orygen
La comparaison proposée par Lorenz n'est pas inintéressante - à condition que les prémisses à "examiner" ne deviennent à "confirmer".
J'ai le sentiment - peut-être injustifié- que la proposition de base oriente une réflexion qui vise à la corroborer: on va rechercher ce qui dans l'évolution culturelle peut être similaire à un phénomène biologique et s'aveugler sur ce qui en réfuterait l'idée.
S'agissant des phénomènes linguistiques, il est vrai qu'on peut observer l'amorce d'une uniformisation: en est-ce vraiment une ou bien n'est-ce qu'une conséquence des avancées technologiques en matière de communication - conséquence qui n'est remarquable que parce qu'on souhaite en faire la preuve d'une thèse préalable ?
Or il est vrai que les jeunes générations parlent un peu plus l'anglais que les générations de mes grand parents; cela est lié à un certain nombre de "conditions favorables": ceux qui étaient chargés d'enseigner l'anglais à mes grand parents ne le parlaient pas eux mêmes. Pour autant, nous sommes très loin de la généralisation de la pratique de cette langue et lorsque je considère l'évolution entre le moment où les conditions invoquées sont apparues et aujourd'hui, je me dis que nous traînons singulièrement la patte pour ce qui est de la maîtrise de cette langue.
Il y a aujourd'hui beaucoup plus d'individus qui se voient proposer un enseignement de l'anglais - parce que la proportion d'individus menés vers les études secondaires et supérieures et beaucoup plus importantes qu'elle n'était.
Pourtant, malgré ces conditions favorables, la proportions de français capables d'aligner trois mots en anglais (et j'ose à peine évoquer les autres langues) est ridiculement bas.
Saussure observait un double mouvement "contradictoire" dans l'évolution linguistique : généralisation ET singularisation. Nous avons abandonné les dialectes pour le français (généralisation), mais dès qu'une catégorie se forme, elle se crée un "pseudo-dialecte " particulier (sous la forme de ce qu'on appelle les particularismes locaux/professionnels, etc.). Les deux niveaux de langage ayant une portée et des fonctions différentes.
Anonyme
Citation :la proposition de base oriente une réflexion qui vise à la corroborer: on va rechercher ce qui dans l'évolution culturelle peut être similaire à un phénomène biologique et s'aveugler sur ce qui en réfuterait l'idée.
Ouais, en science, on appelle ça une démarche inductive.
Il eut fallu s'inscrire dans une démarche hypothético-déductive :
Émettre une hypothèse et tenter d'accumuler les cas qui la réfutent.
Tant que rien ne réfute cette hypothèse on la considère alors comme "valide" ; dans le cas contraire on affine l'hypothèse initiale pour tenir compte des observations... ou on change de job !
Je vous laisse entre vous.
quantat
Citation de : _Geronimo_
Hors sujet :Citation :la proposition de base oriente une réflexion qui vise à la corroborer: on va rechercher ce qui dans l'évolution culturelle peut être similaire à un phénomène biologique et s'aveugler sur ce qui en réfuterait l'idée.
Ouais, en science, on appelle ça une démarche inductive.
Il eut fallu s'inscrire dans une démarche hypothético-déductive :
Émettre une hypothèse et tenter d'accumuler les cas qui la réfutent.
Tant que rien ne réfute cette hypothèse on la considère alors comme "valide" ; dans le cas contraire on affine l'hypothèse initiale pour tenir compte des observations... ou on change de job !
Je vous laisse entre vous.
C'est juste ce que tu dis là...(bien que tu évoques plus le vérificationnisme qui s'est historiquement associé à l'inductivisme que la démarche inductive elle même) mais on est pas obligé de changer de job si l'hypothèse est réfutée (l'hypothèse ici en cause est elle réellement réfutable ?)... on peut aussi changer l'hypothèse ![]()
oryjen
la proposition de base oriente une réflexion qui vise à la corroborer: on va rechercher ce qui dans l'évolution culturelle peut être similaire à un phénomène biologique et s'aveugler sur ce qui en réfuterait l'idée.
Ce n'est pas le sentiment qui domine à la lecture du bouquin, dont la méthode est tout de même de haute tenue intellectuelle.
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
quantat
Je n'ai pas lu le bouquin; je vais donc me contenter de souligner quelques assertions qui peuvent plaire au "sens commun" et qui me posent de sérieuses difficultés:
Citation :
1) C'est la diversité des pressions de sélection, la multiplicité des exigences, qui pousse le grand devenir organique vers les niveaux supérieurs.
2) Cette orientation semble bien plutôt commandée par les éternels facteurs qui étaient déjà à l'oeuvre dans la détermination de l'évolution phylogénétique de nos ancêtres pré-humains.
3) Tous les peuples hautement civilisés de la terre luttent avec les mêmes armes, emploient les mêmes technologies et -ce qui est sans doute déterminant- commercent sur le même marché mondial, essayant de se dépasser les uns les autres avec les mêmes moyens.
1) L'idée de niveau supérieur est une croyance d'ordre culturel - largement contestable (et contestée). Elle implique des jugements de valeur qui n'ont rien de scientifiques (c'est à dire de "réfutable")
2) L'évocation de ces "facteurs éternels" repose sur un mauvais raisonnement : l'auteur feint de croire qu'il n'y a que deux possibilités (ces facteurs éternels vs les valeurs des sociétés); il est ainsi assuré qu'en éliminant l'une d'elles, il ne reste plus que l'autre. Il est en train, tranquillement, de réintroduire des Principes métaphysiques (à ce titre sa démarche ressemble à celle des partisans de l'intelligent design - en prenant toutefois la peine de se donner une caution pseudo scientifique: sa référence au darwinisme n'est que de nature métaphorique)
3)Voilà la clé de la circularité de sa démarche : il exclut implicitement du champ des "peuples hautement civilisés" ceux là même qui pourraient être invoqués pour récuser son affirmation - puisque la "hauteur" de la civilisation sera jugée à l'aune des technologies employées.
Dès lors son propos devient irréfutable
[ Dernière édition du message le 27/08/2014 à 13:05:15 ]
Anonyme
tout à fait d'accord sur le premier point. sur le deuxième, les termes mêmes ("facteurs éternels") me semblent douteux.
troisième point : ben, je suis d'accord aussi en fait.
oryjen
Belle rigueur intellectuelle quantat!

--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
Anonyme
de notions de culture et de civilisation basés sur des croyances qui leurs auraient fait construire des édifices
ou des groupes structurés selon des idées disparates etc etc...bref de tout ce qui fait que nous autres humains soyons dans de beaux draps avec "tout ce que nous avons compris".
Korzybski en parle plutôt bien:
Time binding:
The human ability to pass information and knowledge from one generation to the next. Korzybski claimed this to be a unique capacity, separating people from animals. This distinctly human ability for one generation to start where a previous generation left off, is a consequence of the uniquely human ability to move to higher and higher levels of abstraction without limit.
Animals may have multiple levels of abstraction, but their abstractions must stop at some finite upper limit; this is not so for humans: humans can have 'knowledge about knowledge','knowledge about knowledge about knowledge', etc., without any upper limit. Animals possess knowledge, but each generation of animals does things pretty much in the same way as the previous generation, limited by their neurology and genetic makeup.
For example, at one time most human societies were hunter-gatherers, but now more advanced means of food production (growing, raising, or buying) predominate. Except for some insects (for example, ants), all animals are still hunter-gatherer species, even though many have existed longer than the human species. For this reason, animals are regarded in general semantics as space-binders, and plants, which are usually stationary, as energy-binders.
Quoiqu'il en soit, quiconque a sous la main un ou plusieurs animaux "de compagnie", et les observe, ne peut que tirer la conclusion inverse.
Dans ce cas-là, je te répondrai en te citant:
comment observe-t-on la conceptualisation à l'intérieur d'une conscience?
[ Dernière édition du message le 05/09/2014 à 09:56:52 ]
quantat
Je crois que sur cette question de la différence entre la conscience humaine et la conscience animale, il suffit de considérer tout ce que le langage articulé rend possible.
Les langues humaines sont doublement structurées
1) les sons que nous employons ne sont plus des sons naturels, mais deviennent porteur d'une fonction, qui pour chaque langue est définie par le système phonologique (un son donné n'a pas la même valeur d'une langue à une autre - un r roulé ou grasseyé auront la même fonction en français mais pas en arabe).
Cette utilisation doit faire l'objet d'un apprentissage ;les sons employés par les animaux sont - pour leur très grande majorité- purement naturels et ne font pas l'objet d'un tel apprentissage.
2) la structuration grammaticale autorise une finesse dans l'expression et dans la construction de pensées élaborées
Seul un langage articulé permet la "réflexion" (qui doit être distinguée du "calcul", ou de la "projection imaginaire" dont l'animal semble capable), si on définit celle ci comme "dialogue avec soi même".
Enfin la constitution atomique de notre langage rend possible une écriture - écriture qui a son tour a rendu possible la science moderne, via le développement du langage mathématique.
Jusqu'à présent, le "langage" le plus développé qu'on ait pu découvrir chez des animaux comporte quelque chose comme quatre syllabes et une seule règle grammaticale (combinaison de deux syllabes)
Restent des modes de communication qu'on a pas réussi à déchiffrer (les dauphins) et qui nous conduiront peut-être à reconsidérer tout ça.
quantat
On peut remarquer au passage que le "sens" que nous donnons aux choses, à notre vie, etc... vient de la possibilité de produire des figures de style (ça nous permet de ne pas avoir l'impression de vivre dans une boucherie) ; il en va de même pour l'humour et le langage de la séduction.
On ne peut produire de figure de style que dans un langage où le signifiant peut être dissocié de son signifié conventionnel.
oryjen
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
oryjen
Pourtant, aucun de nous n'est prêt à réduire ce précieux sentiment aux manifestations physiques auxquelles il donne lieu, au simple prétexte qu'elles ont lieu, et sont les seules observables expérimentalement (et peut-être ici avons-nous tort, mais comment le dire avec certitude?).
Par contre, nous ne nous gênons pas pour regarder avec condescendance et amusement les "mécanismes de séduction" d'une autre espèce animale, chez qui nous reconnaissons à cette occasion pourtant des phénomènes biologiques ressemblant trait pour trait à ceux qui nous agitent en pareille circonstance, et pour prétendre avec une belle assurance qu'il n'y a là rien d'autre que de la biologie, PUISQUE c'est de la biologie qu'on observe.
Mais les oiseaux aussi sont fous d'amour!
Comment peut-on se permettre de nier aux autres vivants la subjectivité que nous ne pouvons pas davantage, avec notre arsenal de biologie, prouver chez le premier de nos semblables?
On dira que la preuve peut en être administrée par un autre moyen: celui du langage.
Une minute: est-on sérieusement, scientifiquement en train de dire que les animaux n'ont pas de langage? A propos de conduites amoureuses, précisément?
Certainement pas! Tous les biologistes, zoologues, éthologues le savent parfaitement.
Par contre nous n'avons pas l'humilité de reconnaître que ce langage, seul lieu où peut s'ancrer le subjectif qui manque à la démonstration, nous ne le comprenons sans doute pas avec la précision et la subtilité nécessaire.
La césure, s'il en existe vraiment une, bien qu'il ne soit pas difficile de comprendre à quel point, pour nous subjectivement, en justification de nos crimes, il est vital d'en poser une, ne se trouve pas ici.
Considérant un homme, observé objectivement, on est obligé philosophiquement, pour lui accorder la dignité nécessaire, de faire un parallèle entre les manifestations extérieurement observables de sa conscience et l'existence de sa subjectivité.
J'aimerais bien savoir par quel tour de passe-passe, remplaçant sous les projecteurs l'homme par l'animal, on peut défendre le fait de parvenir, par les mêmes moyens, à des conclusions différentes.
Mon sentiment personnel, tiré d'années à cheminer quotidiennement de conserve avec des animaux domestiques, sauvages, apprivoisés, est qu'il n'y a pas de césure. Nous nous entendons tous sur l'essentiel, tous les vivants.
L'éthologie appliquée au comportement humain montre à quel point ce qui nous apparaît subjectivement comme un ensemble immense et chatoyant de réalités, faits et postures différents et infiniment nuancés, peut objectivement se réduire à l'expression de quelques tropismes peu nombreux.
Je ne dis pas ici qu'il est légitime, philosophiquement parlant, d'opérer cette réduction, eu égard à la dignité de l'homme et de ses oeuvres, etc...
Mais pourquoi donc, alors que l'on reconnaît aussi, par les mêmes moyens, l'expression des mêmes tropismes chez la plupart des autres vivants, cette réduction serait-elle légitime hors l'humanité? Je ne vois nulle part aucun moyen sérieux de l'affirmer.
Par contre, une réponse hélas très simple se profile automatiquement: Nous TENONS mordicus à perpétuer le confort que nous procure, dans nos rapports avec les autres vivants (dont nous consommons les corps par l'usage de la violence), le sentiment indiscutable (et malheureusement indiscuté) de notre supériorité ontologique, comme nous l'ont raconté, en manière de consolation, tous nos chamanes depuis la nuit des temps, les braves gens...
Et à propos de conceptualisation, que fait donc celui-ci?
--------------------------------------------------------------------------------
L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
[ Dernière édition du message le 06/09/2014 à 05:02:22 ]
Anonyme
Et à propos de conceptualisation, que fait donc celui-ci?
Il fait ce qu'il a à faire.
Peut-on être intelligent sans pour autant avoir recours à un concept? et vice-versa?
Une minute: est-on sérieusement, scientifiquement en train de dire que les animaux n'ont pas de langage? A propos de conduites amoureuses, précisément?
Certainement pas! Tous les biologistes, zoologues, éthologues le savent parfaitement.
Par contre nous n'avons pas l'humilité de reconnaître que ce langage, seul lieu où peut s'ancrer le subjectif qui manque à la démonstration, nous ne le comprenons sans doute pas avec la précision et la subtilité nécessaire.
Ben justement je crois que cette subtilité nous échappe parce que nous y cherchons plus que ce qu'elle est réellement.
C'est une vraie subtilité.
Dans le dernier livre dont je parle, je cite un passage dans lequel un jeune commandant connaissant la théorie sur le bout des doigts fait échouer son cargo sur un banc de sable. Il calcule et re-calcule pour trouver son erreur.
Or cette subtilité qu'il cherchait dans les chiffres est un phénomène figurant dans aucun livre.
Seul l'indigène, vivant et observant son environnement direct peut le savoir.
Il ne le quantifie/notifie/conceptualise pas pour autant, au sens scientifique du terme.
Il sait.
Mon sentiment personnel, tiré d'années à cheminer quotidiennement de conserve avec des animaux domestiques, sauvages, apprivoisés, est qu'il n'y a pas de césure. Nous nous entendons tous sur l'essentiel, tous les vivants.
Je crois ça aussi, et cet essentiel est subtil mais bien palpable et n'a pas nécessairement besoin d'un langage articulé, ni d'un concept.
[ Dernière édition du message le 06/09/2014 à 06:32:01 ]
- < Liste des sujets
- Charte
